Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
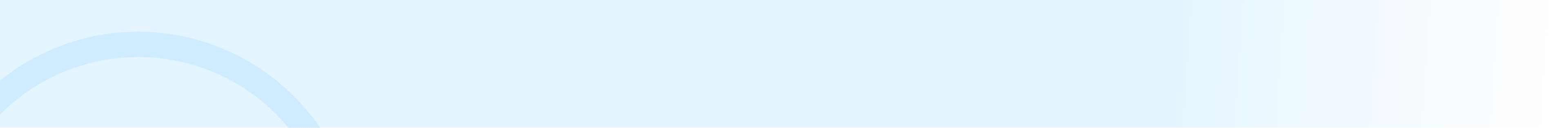
Tous les quatre ans, des milliers de salariés élisent leurs représentants au comité social et économique. Mais derrière ce scrutin, se cachent des règles strictes : seuil d’effectif à 11 salariés, parité femmes-hommes, calendrier électoral, risques de carence ou encore sanctions en cas de manquement. Pour les employeurs comme pour les élus, bien maîtriser les élections CSE, c’est sécuriser à la fois le dialogue social et la conformité juridique de l’entreprise.
Tour d’horizon complet des obligations, délais, sanctions et outils pratiques pour organiser vos élections CSE en toute conformité.
Le déclenchement des élections du CSE obéit à des règles précises : seuil d’effectif, obligation d’information, cas particuliers et durée des mandats structurent le point de départ de toute procédure électorale.
Le déclenchement des élections professionnelles repose sur une règle claire : toute entreprise atteignant un effectif d’au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs doit mettre en place un CSE.
Ce seuil est apprécié en équivalents temps plein (ETP), selon les règles définies aux articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du Code du travail.
Cela signifie qu’il ne suffit pas d’avoir 11 salariés ponctuellement : l’effectif doit avoir été atteint ou dépassé sans discontinuité pendant une période d’un an.
À noter :
Ce décompte conditionne non seulement l’obligation d’organiser des élections, mais également le nombre de sièges, la composition des collèges électoraux et la création éventuelle d’un CSE central en cas de multi-établissements.
Bon à savoir
Le calcul de l’effectif est souvent source de litiges. Il doit s’appuyer sur le registre unique du personnel (RUP) et prendre en compte les entrées/sorties sur 12 mois. C’est ce décompte qui détermine l’existence même du CSE et le nombre d’élus à prévoir.
Dès que le seuil est franchi, l’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ».
L’article L.2314-4 du Code du travail précise que cette information doit mentionner la date envisagée pour le premier tour, lequel doit avoir lieu au plus tard dans les 90 jours suivant la diffusion.
En pratique :
Extrait du Code du travail – Article L.2314-4
« Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi (...), l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections (...). Le premier tour doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. »
En dehors du renouvellement classique tous les quatre ans (L.2314-33), certaines situations imposent d’organiser des élections anticipées. L’article L.2314-10 prévoit des élections partielles si un collège n’est plus représenté ou si la moitié des titulaires manque. De plus, selon L.2314-4, un salarié ou une organisation syndicale peut exiger le déclenchement du scrutin, que l’employeur doit alors organiser dans un délai d’un mois.
Les élections doivent être organisées tous les 4 ans, sauf accord collectif fixant une durée comprise entre 2 et 4 ans (voir § 2.4). L’employeur doit prendre l’initiative de ce renouvellement.
Conformément à l’article L.2314-10 du Code du travail, des élections partielles doivent être organisées dans deux cas :
Ces élections ne sont pas nécessaires si la fin du mandat des élus intervient dans moins de 6 mois.
Si l’employeur ne prend pas l’initiative d’organiser les élections, tout salarié ou toute organisation syndicale représentative peut le mettre en demeure.
L’employeur doit alors lancer la procédure dans un délai d’un mois à compter de la demande.
Le salarié à l’origine de la demande bénéficie d’une protection contre le licenciement, à condition que sa démarche soit confirmée par une organisation syndicale.
En résumé
Renouvellement : tous les 4 ans (ou 2 à 4 ans par accord).
Partielles : si un collège n’est plus représenté ou si moitié des titulaires ont quitté leur mandat.
Demande : un salarié ou un syndicat peut déclencher la procédure, l’employeur a 1 mois pour l’organiser.
En principe, le mandat d’un élu du CSE dure quatre ans (article L.2314-33 du Code du travail). Néanmoins, un accord collectif, qu’il soit conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise, peut en fixer une durée différente, à condition qu’elle soit comprise entre deux et quatre ans.
Depuis les ordonnances Macron de 2017, un élu ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs au sein du CSE (article L.2314-33).
Deux exceptions existent :
Depuis 2024, la pertinence de cette limitation fait débat. Plusieurs propositions visent à supprimer la règle des trois mandats successifs, afin de préserver la continuité de la représentation du personnel, notamment dans les petites structures où il est parfois difficile de trouver des candidats.
À ce jour (septembre 2025), la règle demeure en vigueur. Il est donc indispensable de vérifier l’état de la législation au moment de l’organisation des élections, car une réforme pourrait modifier ce cadre.
Petit point historique
La limitation à trois mandats successifs a été instaurée par les ordonnances Macron de 2017 pour encourager le renouvellement des élus. Mais dans les petites entreprises, elle a souvent été jugée contraignante, ce qui explique les assouplissements et les discussions actuelles sur son éventuelle suppression.
Le calcul de l’effectif conditionne tout le processus électoral : c’est lui qui déclenche l’obligation d’organiser des élections, fixe le nombre de sièges au CSE, détermine les collèges électoraux et, le cas échéant, l’existence d’un CSE central.
Selon l’article L.1111-2 du Code du travail, doivent être comptabilisés :
| Catégorie de salariés | Prise en compte dans l’effectif |
|---|---|
| CDI à temps plein | Pris en compte intégralement, y compris en période d’essai, en congé ou en arrêt maladie. |
| Temps partiel | Comptés au prorata de la durée contractuelle rapportée à la durée légale ou conventionnelle de travail. |
| CDD | Intégrés au prorata de leur temps de présence sur les 12 derniers mois. |
| Intérimaires ou en portage | Pris en compte lorsqu’ils travaillent depuis au moins un an dans l’entreprise utilisatrice, au prorata de la durée de mission. |
| Salariés mis à disposition | Intégrés après un an de présence continue dans les locaux de l’entreprise utilisatrice. |
Extrait du Code du travail — Article L.1111-2
« Sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise (...) les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an. »
Certains salariés ne sont pas intégrés dans le calcul, conformément à l’article L.1111-3 du Code du travail. Il s’agit notamment de :
Cette exclusion évite un double comptage et reflète plus fidèlement la structure réelle et durable de l’effectif de l’entreprise.
Pour mesurer l’effectif, on calcule le nombre d’équivalents temps plein (ETP) sur les 12 mois consécutifs.
Exemple simplifié :
Le total d’ETP obtenu permet de déterminer si l’entreprise franchit ou non le seuil de 11 salariés.
L’outil principal pour fiabiliser ce calcul est le Registre unique du personnel (RUP). Il récapitule toutes les entrées et sorties, les types de contrats, et facilite le suivi par établissement, indispensable lorsqu’il faut déterminer s’il faut mettre en place un CSE d’établissement ou un CSE central.
Définition – CSE central
Le CSE central est l’instance représentative mise en place dans les entreprises qui comptent plusieurs établissements distincts. Il regroupe les représentants des différents CSE d’établissement et traite des sujets concernant l’ensemble de l’entreprise (orientations stratégiques, politique sociale, restructurations...).
Le résultat du calcul d’effectif a des conséquences directes sur la mise en place et l’organisation des élections du CSE.
À titre illustratif, voici un extrait simplifié du tableau de l’article R.2314-1 du Code du travail. Il fixe le nombre d’élus titulaires et suppléants en fonction de l’effectif. Ce tableau n’est pas exhaustif : la version complète est consultable directement sur Légifrance.
| Effectif de l’entreprise | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
|---|---|---|
| 11 à 24 salariés | 1 | 1 |
| 25 à 49 salariés | 2 | 2 |
| 50 à 74 salariés | 4 | 4 |
| 75 à 99 salariés | 5 | 5 |
| 100 à 124 salariés | 6 | 6 |
| 125 à 149 salariés | 7 | 7 |
| 150 à 174 salariés | 8 | 8 |
| 175 à 199 salariés | 9 | 9 |
| 200 à 249 salariés | 10 | 10 |
| 250 à 399 salariés | 11 | 11 |
| 400 à 499 salariés | 12 | 12 |
| 500 à 599 salariés | 13 | 13 |
| 600 à 699 salariés | 14 | 14 |
| 700 à 799 salariés | 15 | 15 |
| 800 à 899 salariés | 16 | 16 |
| 900 à 999 salariés | 17 | 17 |
| 1000 à 1249 salariés | 18 | 18 |
Référence utile
Le tableau des effectifs et du nombre de sièges figure à l’article R.2314-1 du Code du travail. Il est la base légale pour savoir combien d’élus titulaires et suppléants doivent être désignés dans chaque entreprise.
Lorsque l’entreprise comprend plusieurs sites ou entités, se pose la question de savoir s’ils doivent chacun être considérés comme un établissement distinct. De cette distinction découle la mise en place de CSE d’établissement et, automatiquement, d’un CSE central chargé de regrouper leurs représentants à l’échelle de l’entreprise.
Le Code du travail privilégie la négociation collective pour définir le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Cette approche permet d’adapter la représentation à la réalité de l’entreprise, en évitant un découpage trop théorique ou imposé unilatéralement.
Accord d’entreprise majoritaire
Un accord d’entreprise est dit « majoritaire » lorsqu’il est signé par des organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. C’est aujourd’hui la condition pour qu’un accord soit valable et applicable à tous les salariés.
En l’absence d’accord, l’employeur peut fixer seul le nombre et le périmètre des établissements distincts (article L.2313-4). Mais cette possibilité est strictement encadrée :
La jurisprudence l’a rappelé : la Cour de cassation (arrêt du 17 avril 2019, n° 18-23.764) a jugé qu’une décision unilatérale n’est valable qu’à condition qu’une négociation ait réellement été menée. À défaut, la décision est nulle.
Extrait de jurisprudence
« Ce n’est que si, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, aucun accord n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts. » (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-23.764)
La notion d’établissement distinct repose avant tout sur le critère d’autonomie de gestion du responsable local, notamment en matière de gestion du personnel.
Cette définition figure à l’article L.2313-4, complété par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, qui a instauré le CSE.
En pratique, c’est souvent ce critère d’autonomie RH qui sert de ligne directrice pour trancher, parfois après contentieux devant la DREETS ou le tribunal judiciaire.
Le droit de participer aux élections professionnelles du CSE distingue deux notions : être électeur (avoir le droit de voter) et être éligible (avoir le droit de se présenter comme candidat). Ces statuts obéissent à des règles spécifiques, prévues par le Code du travail et régulièrement adaptées par le législateur.
Selon l’article L.2314-18 du Code du travail, sont électeurs au CSE :
Les salariés mis à disposition (intérim, sous-traitance, portage) peuvent aussi être électeurs, mais seulement s’ils remplissent deux conditions :
En clair
Peuvent voter : tous les salariés de plus de 16 ans, avec au moins 3 mois d’ancienneté, sauf s’ils ont perdu leurs droits civiques. Les intérimaires ou mis à disposition peuvent voter s’ils sont présents depuis un an continu dans l’entreprise.
L’article L.2314-19 du Code du travail fixe les conditions pour être candidat aux élections du CSE :
Particularités :
La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 est venue modifier les règles d’électorat et d’éligibilité en introduisant une distinction pour les personnes bénéficiant d’une délégation particulière d’autorité.
Objectif : garantir que les salariés occupant des fonctions de direction puissent voter mais éviter qu’ils siègent en tant qu’élus, ce qui créerait un conflit d’intérêts.
Référence légale
Article L.2314-18 modifié par la loi du 21 décembre 2022 : « Sont électeurs les salariés de l'entreprise âgés de seize ans révolus (...) y compris ceux bénéficiant d'une délégation particulière d'autorité. Ces derniers ne sont pas éligibles. »
Les élections du CSE ne se font pas dans un seul bloc. Pour garantir que toutes les catégories de salariés soient représentées, la loi impose un découpage en collèges électoraux. Ensuite, le nombre d’élus est fixé par un tableau officiel du Code du travail, en fonction de la taille de l’entreprise.
Trois catégories principales existent :
Dans les très petites structures où il n’y a qu’un titulaire et un suppléant à élire, un collège unique peut regrouper tous les salariés.
Dans les grandes entreprises (≥ 501 salariés), la loi veille à ce que les cadres et assimilés aient au moins un siège garanti.
Le nombre d’élus (titulaires et suppléants) n’est pas décidé librement : il est fixé par un tableau officiel (article R.2314-1 du Code du travail).
Exemple :
Le tableau complet, qui va jusqu’aux très grandes entreprises, est disponible sur Légifrance.
À retenir
Le tableau officiel du Code du travail fixe seulement le nombre total de sièges (titulaires et suppléants). La répartition de ces sièges entre les différents collèges est ensuite définie dans le protocole d’accord préélectoral (PAP).
Une fois le nombre total de sièges fixé par la loi, il faut les répartir entre les collèges. C’est le rôle du PAP, négocié entre l’employeur et les syndicats.
Exemple
Entreprise de 120 salariés → le tableau impose 6 titulaires.
Effectif : 70 ouvriers/employés, 40 TAM/IC, 10 cadres.
Répartition proposée : 3 sièges pour le 1er collège, 2 pour le 2e, 1 pour le 3e.
Chaque catégorie a au moins un siège, ce qui garantit une représentation équilibrée.
Depuis 2017, la loi impose que les listes de candidats au CSE reflètent la répartition femmes-hommes de l’entreprise. L’objectif est clair : assurer une représentation équilibrée des deux sexes parmi les élus. Le non-respect de ces règles entraîne des sanctions sévères pouvant aller jusqu’à l’annulation de l’élection de certains candidats.
L’article L.2314-30 du Code du travail impose que la proportion de femmes et d’hommes sur chaque liste corresponde à leur présence dans chaque collège électoral.
Exemple :
Le calcul doit être fait collège par collège, et non sur l’ensemble de l’entreprise.
À retenir
Les listes de candidats doivent respecter la proportion femmes-hommes présente dans chaque collège électoral. Une liste déséquilibrée expose à l’annulation des élus surnuméraires.
La loi ne se limite pas à la proportion : elle impose aussi une alternance stricte dans l’ordre de présentation des candidats.
Cette alternance vise à éviter que les femmes soient placées systématiquement en bas de liste, réduisant ainsi leurs chances d’être élues.
Extrait clé — Cass. soc., 9 mai 2018
« Le non-respect de la représentation proportionnelle femmes-hommes entraîne l’annulation de l’élection des candidats surnuméraires du sexe surreprésenté. »
Pour vérifier rapidement la conformité de vos listes avec la règle de parité, l’UNSA propose un simulateur pratique dédié à la répartition hommes/femmes.
Les élections du CSE suivent un calendrier légal strict. Chaque étape est encadrée par le Code du travail afin de garantir la régularité du scrutin et d’éviter toute contestation ultérieure.
Voici, étape par étape, le déroulé pratique du scrutin et les délais à respecter :
| Étape | Délai | Contenu |
|---|---|---|
| Information du personnel | J - 90 | Annonce officielle des élections, avec date envisagée du 1er tour (affichage, courrier, intranet). |
| Invitation des OS et négociation du PAP | J - 60 à J - 45 | L’employeur invite les syndicats représentatifs et négocie le protocole d’accord préélectoral (répartition des sièges, modalités de vote, parité). |
| Affichage des listes électorales et dépôt des candidatures | J - 15 à J - 4 | Affichage des électeurs par collège, dépôt des listes de candidats, affichage des candidatures validées. |
| 1er tour | Jour J | Scrutin réservé aux listes syndicales. Quorum atteint si ≥ 50 % des inscrits. PV ou carence si aucune candidature. |
| 2d tour (si nécessaire) | J + 15 | Ouvert aux candidatures libres si quorum non atteint ou sièges vacants. Dépouillement et proclamation des résultats. |
| Transmission des PV | Sous 15 jours après scrutin | PV envoyés à l’inspection du travail, au CTEP (Arras) et aux syndicats concernés. |
Le Code du travail autorise plusieurs modes de vote aux élections professionnelles, à condition que les règles de confidentialité, de sécurité et de sincérité du scrutin soient respectées. Trois modalités sont possibles : vote sur site, par correspondance ou par voie électronique. En revanche, le vote par procuration est interdit.
C’est la forme la plus traditionnelle : les électeurs votent en se déplaçant physiquement dans un bureau de vote installé dans l’entreprise.
C’est la méthode qui offre la plus grande transparence, mais elle peut poser des difficultés pratiques dans les entreprises multi-sites ou avec de nombreux salariés en télétravail.
Le vote par correspondance est possible pour les salariés absents le jour du scrutin (maladie, congés, salariés en mission, etc.).
Le non-respect de la procédure (enveloppes mal conformes, délais non respectés) peut entraîner l’annulation du scrutin par le juge.
Depuis l’ordonnance n° 2017-1386, le vote électronique est expressément autorisé aux élections CSE, à condition de respecter un cahier des charges strict fixé par le décret du 25 avril 2007, sous réserve des textes subséquents.
Garanties obligatoires :
En pratique, l’entreprise doit recourir à un prestataire agréé pour garantir la conformité juridique et technique du scrutin.
À retenir
Le vote électronique est valable uniquement si le système respecte les exigences légales de confidentialité, sécurité et traçabilité. En cas de faille, l’élection peut être contestée devant le juge.
Le vote par procuration (un salarié vote à la place d’un autre) est formellement interdit aux élections CSE.
Toute irrégularité liée à des procurations entraîne l’annulation pure et simple du scrutin.
Le vote ne met pas fin à la procédure électorale : une série de formalités légales doit encore être respectée pour valider définitivement le scrutin et installer le nouveau CSE.
À l’issue du dépouillement, le bureau de vote proclame les résultats publiquement et oralement. L’affichage des résultats est réalisé immédiatement dans l’entreprise, de manière à ce que tous les salariés puissent en prendre connaissance.
L’affichage doit mentionner : nombre d’électeurs inscrits, nombre de votants, nombre de suffrages exprimés, répartition par liste, noms des élus titulaires et suppléants.
La proclamation déclenche le délai de recours contentieux (15 jours devant le tribunal judiciaire).
Un procès-verbal (PV) doit être rédigé pour chaque collège électoral.
Dans les 15 jours suivant la fin du scrutin :
Tout retard ou omission peut fragiliser la régularité des élections.
En clair
Pas de PV = pas d’élections valides. Les procès-verbaux sont la preuve juridique du scrutin et leur transmission est obligatoire aux autorités.
Une fois les résultats validés et les PV transmis, le CSE entre en fonction. Concrètement :
C’est à ce moment-là que l’instance représentative prend vie et peut commencer à exercer ses missions (santé, sécurité, conditions de travail, activités sociales et culturelles).
Même bien préparées, les élections du CSE peuvent donner lieu à des contestations. Le Code du travail fixe des délais très stricts pour déposer un recours, et le tribunal judiciaire est seul compétent pour trancher.
| Type de contestation | Délai | Objet | Référence |
|---|---|---|---|
| Électorat et listes | 3 jours après publication | - Inscription ou non sur la liste électorale - Composition des listes de candidats (parité, équilibre) |
Art. R.2314-24 |
| Régularité du scrutin | 15 jours après proclamation | - Validité du scrutin (irrégularités, non-respect du PAP) - Neutralité de l’employeur - Conformité des résultats |
Art. R.2314-24 |
| Compétence du tribunal judiciaire | Décision définitive | - Statue en dernier ressort (pas d’appel) - Procédure par requête au greffe - Pouvoirs : annuler une élection, ordonner un nouveau scrutin, valider malgré contestation |
Tribunal judiciaire |
Jurisprudences récentes
Neutralité de l’employeurCass. soc., 10 avr. 2019, n° 18-22.948 : l’employeur doit rester neutre, toute influence sur le vote peut entraîner l’annulation du scrutin.
Pressions syndicalesCass. soc., 15 janv. 2020, n° 19-10.630 : des pressions ou manœuvres d’un syndicat peuvent justifier l’annulation de l’élection.
Irrégularités procéduralesCass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-29.022 : une omission dans le respect des délais ou des formalités (ex. affichage tardif) peut suffire à invalider le scrutin.
Il arrive qu’aucune candidature ne soit déposée ou que le quorum ne soit pas atteint. Dans ce cas, on parle de carence, totale ou partielle. Cette situation ne dispense pas l’employeur de respecter des formalités précises, car elle doit être constatée officiellement et transmise aux autorités.
La carence peut prendre deux formes différentes, qu’il est important de distinguer, car leurs conséquences ne sont pas identiques :
| Type de carence | Définition | Conséquence immédiate |
|---|---|---|
| Carence totale | Aucun candidat ne se présente, ni au 1er tour (listes syndicales), ni au 2d tour (candidatures libres). Aucun siège n’est pourvu. | Le CSE n’est pas mis en place. Un procès-verbal de carence totale doit être rédigé et transmis aux autorités. |
| Carence partielle | Des candidatures existent, mais pas assez pour occuper tous les sièges prévus. Exemple : 4 sièges à pourvoir, seulement 2 candidats élus. | Le CSE est constitué, mais avec des sièges vacants. Un procès-verbal de carence partielle doit être établi pour constater les postes non pourvus. |
Dans les deux cas, l’employeur est tenu d’établir un procès-verbal de carence (Cerfa n° 1524804). Ce document officiel permet de constater, selon la situation, soit l’absence complète de candidats, soit l’impossibilité de pourvoir certains sièges.
L’employeur doit rédiger un procès-verbal de carence (Cerfa n° 1524804).
L’absence de PV constitue un délit d’entrave.
À retenir
Même sans candidats, la procédure doit aller jusqu’au bout : un PV de carence est obligatoire et doit être transmis aux autorités.
En cas de carence, l’entreprise reste sans CSE pour la durée du mandat en cours. Néanmoins, la situation n’est pas figée : un salarié ou une organisation syndicale peut demander l’organisation de nouvelles élections après un délai de six mois. L’employeur doit alors engager la procédure dans le mois qui suit. La carence n’a donc qu’un effet temporaire : elle suspend la représentation du personnel mais ne supprime pas, à terme, l’obligation d’élire un CSE si une demande est formulée.
Particularité — Entreprises de 11 à 20 salariés
Si aucun salarié ne se porte candidat dans les 30 jours suivant l’information du personnel (J-90), l’employeur est dispensé d’inviter les syndicats à négocier un PAP. Il établit alors directement un procès-verbal de carence. Cette règle vise à alléger la procédure dans les petites structures où il est fréquent qu’aucun candidat ne se présente.
Ne pas organiser les élections du CSE alors que l’effectif le requiert expose l’employeur à des sanctions lourdes, aussi bien pénales que civiles. Les conséquences touchent à la fois le droit collectif (validité des accords, gestion sociale) et le droit individuel (licenciements, protection des salariés).
| Type de sanction | Conséquences | Référence |
|---|---|---|
| Sanctions pénales (délit d’entrave) |
- Non-organisation des élections = délit d’entrave - Peine : 1 an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende - Objectif : protéger la liberté de représentation des salariés |
Art. L.2317-1 |
| Sanctions prud’homales | - Saisine possible du conseil de prud’hommes - Attribution de dommages-intérêts aux salariés - Montant proportionné au préjudice (ex. absence de représentation) |
Jurisprudence prud’homale |
| Droit collectif | - Règlement intérieur inopposable - Impossibilité de conclure un accord collectif - Impossibilité de dénoncer un usage ou un engagement unilatéral - Perte des exonérations sociales et fiscales liées à l’intéressement |
Code du travail + accords collectifs |
| Droit individuel | - Licenciement disciplinaire : sans cause réelle et sérieuse - Licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle : nul - Licenciement économique : irrégulier sans consultation du CSE Conséquences : réintégration ou indemnités supplémentaires |
Jurisprudence sociale |
En clair
Pas d’élections = risques majeurs. L’employeur s’expose à une sanction pénale (délit d’entrave), à des condamnations prud’homales, à l’invalidation de ses accords collectifs et à l’annulation de certains licenciements. Autrement dit, l’absence de CSE fragilise toute la gestion sociale de l’entreprise.
Organiser une élection CSE soulève toujours les mêmes interrogations : qui peut voter ? Quand lancer la procédure ? Que faire en cas d’absence de candidats ? Retrouvez ici un condensé des questions fréquentes sur les élections du CSE, avec des explications pratiques.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences