Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
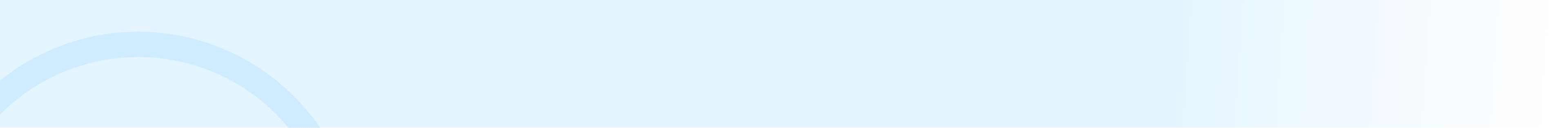
De plus en plus de formateurs croisent, sans forcément le savoir, des stagiaires dys, autistes ou concernés par un TDAH. Les formations ne sont pas toujours pensées pour ces profils : un rythme trop dense, un support peu lisible ou une consigne trop rapide peuvent vite créer un décalage. Il suffit pourtant de quelques ajustements pour rétablir l'équilibre et faciliter la participation. Découvrez ici des conseils concrets pour mieux inclure les apprenants neuroatypiques dans vos sessions de formation.

Dans une salle de formation, chacun apprend à sa manière. Certaines personnes perçoivent, comprennent ou mémorisent les informations différemment. Cette singularité peut relever de ce que l'on appelle la neuroatypie, un terme qui désigne les troubles du neurodéveloppement tels que la dyslexie, l'autisme ou le TDAH.
Ces particularités ne sont pas des « problèmes » à corriger, mais des façons différentes d'aborder l'apprentissage. Elles influencent la concentration, la lecture, la compréhension des consignes ou la gestion sensorielle. En voici quelques exemples :
Neuroatypie et handicap : pas toujours synonyme
Toutes les personnes neuroatypiques (TSA, TDAH, troubles DYS, etc.) ne sont pas forcément reconnues comme étant en situation de handicap.
La différence entre neuroatypie et handicap dépend principalement de l'impact du fonctionnement cognitif sur la vie quotidienne, les apprentissages ou le travail.
D'un point de vue juridique, la loi française (article L.114 du Code de l'action sociale et des familles) définit le handicap comme une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société due à une altération durable d'une ou plusieurs fonctions (mentales, cognitives, psychiques, etc.).
Ainsi, une personne neuroatypique peut être reconnue en situation de handicap si son environnement n'est pas adapté à ses besoins.
D'un point de vue sociétal, le mouvement de la neurodiversité invite à considérer ces différences comme des variations naturelles du fonctionnement humain, et non comme des déficits.
Le « handicap » naît alors de l'inadéquation entre la personne et son environnement, pas de la personne elle-même.
En formation professionnelle, cela signifie :
L'inclusion se prépare bien avant le début de la session. Le formateur doit s'assurer de connaitre les stagiaires et leurs besoins.
Un échange en amont, même rapide, aide à créer un climat de confiance. Cela peut passer par un mail, un appel ou une simple prise de contact. L'objectif est de comprendre comment chacun apprend.
Si nécessaire, un questionnaire peut compléter cette démarche et interroger sur les éléments suivants :
On reste sur le concret, sans aborder le volet médical.
Enfin, désigner un référent identifiable avant le début de la formation aide à fluidifier les échanges. C'est la personne vers qui les participants peuvent se tourner pour toute question ou besoin d'ajustement, avant et pendant la session.
Le lieu de formation, qu'il soit physique ou en ligne, influence directement la qualité d'attention. Un environnement stable et prévisible aide tous les participants, surtout ceux qui sont sensibles aux sons, aux lumières ou à la surcharge visuelle.
Un support bien conçu fait déjà la moitié du travail pédagogique. Il doit permettre à chacun de comprendre sans effort inutile.
Penser l'inclusion en formation, c'est reconnaître que chacun apprend différemment. La conception universelle de l'apprentissage (CUA), aussi appelée pédagogie universelle, repose sur cette idée simple : construire dès le départ des parcours adaptés à tous, sans devoir les retoucher ensuite.
Plutôt que d'imaginer un format « standard » puis d'ajouter des adaptations, la CUA pousse à concevoir des supports qui parlent à une pluralité de profils. Cette approche fluidifie l'apprentissage et évite les ajustements permanents.
Tout le monde n'assimile pas de la même manière. Certains retiennent mieux en lisant, d'autres en écoutant ou en regardant. Proposer plusieurs façons d'aborder le contenu le rend plus clair pour chacun.
Dans l'idéal, pour atteindre un objectif, il faut proposer au moins deux voies d'accès. Un atelier pratique peut être complété par une courte lecture ou une discussion. Un visuel peut soutenir une explication orale. Cette diversité d'approches donne à chacun la possibilité de s'approprier la matière à son rythme.
Inclusion des neuro-atypiques dans le monde professionnel
En France, 1,6 million d’adultes neuro-atypiques sont concernés par l'emploi en milieu ordinaire. Adapter les processus de recrutement et les environnements de travail permet de révéler leurs talents et d'inclure pleinement ces profils.
Source : France Travail, 22/04/2025
Pour inclure au maximum les apprenants neuroatypiques, le formateur doit tenir compte de l'aspect technique mais aussi de la dimension humaine.
Un support accessible est avant tout un support lisible. Il doit aller droit au but, sans distraction visuelle ni sonore :
Les consignes doivent être simples, précises et, si besoin, reformulées. Mieux vaut rappeler l'objectif d'une séquence que multiplier les explications. Découper les activités en étapes courtes aide à maintenir l'attention et donne un sentiment de progression.
Travailler à deux facilite la compréhension. Les binômes permettent d'échanger, de relire les consignes et de s'entraider naturellement. C'est une façon souple de soutenir les apprenants sans isoler qui que ce soit.
Les changements de rythme ou les échanges en groupe peuvent bousculer certains participants. Prévoir un espace ou un moment pour s'isoler quelques minutes aide ceux qui en ont besoin à se recentrer avant de reprendre.
Des retours simples et factuels suffisent ensuite à maintenir l'attention et à garder une ambiance calme jusqu'à la fin.
L'évaluation fait partie intégrante de la formation, mais elle ne doit pas devenir un obstacle. Les objectifs restent les mêmes, seule la forme peut varier : exposé oral, écrit synthétique, schéma, simulation… plusieurs chemins mènent à la même compétence.
Présenter les critères d'évaluation à l'avance, sous une forme visuelle et structurée, aide chacun à comprendre ce qui est attendu.
Certains participants auront besoin de plus de temps pour répondre ou de reformuler leurs idées différemment. Ce n'est pas un aménagement de faveur, mais une manière d'évaluer réellement la compréhension.
Enfin, l'évaluation doit reconnaître la progression individuelle autant que la performance du moment. Une approche qui valorise l'effort, les stratégies mises en place et la montée en compétence favorise la motivation et l'inclusion.
Rendre une formation accessible revient à offrir à chacun une place dans le groupe, quelle que soit sa manière d'apprendre. La neuroatypie fait partie de la réalité des publics, et la formation doit s'y adapter naturellement. Ces aménagements n'altèrent pas l'expérience du reste du groupe : ils instaurent, au contraire un climat plus clair, plus fluide et plus inclusif pour tous.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences