Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
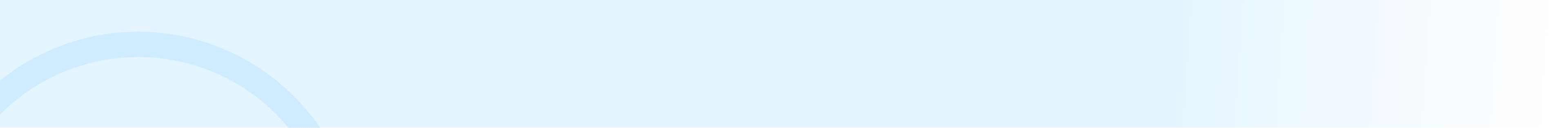
Subventions, avantages, contrôles… Le budget du CSE est devenu un enjeu stratégique autant qu’un casse-tête pour les élus.
Depuis la réforme de 2020, l’instance unique doit jongler entre deux enveloppes bien distinctes : le budget de fonctionnement (AEP), indispensable à son indépendance, et le budget des activités sociales et culturelles (ASC), attendu par les salariés pour améliorer leur quotidien. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une mécanique complexe : règles de calcul basées sur la DSN, plafonds légaux, transferts limités à 10 %, et surtout une frontière parfois floue entre ce qui relève de l’AEP et de l’ASC.
Dans cet article, nous faisons le point sur les règles, les usages, les pièges à éviter et les bonnes pratiques pour gérer efficacement les finances du CSE.
Le comité social et économique (CSE) ne dispose pas des mêmes ressources selon que l’entreprise compte moins ou plus de 50 salariés. En dessous de ce seuil, il a surtout des moyens matériels et un rôle de représentation. Au-delà, il gère deux budgets distincts : le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles (ASC).
Le CSE n’a pas de budget de fonctionnement ni de budget ASC. Les élus exercent leurs missions comme des délégués du personnel et disposent uniquement de moyens matériels pour fonctionner :
Les élus ont aussi droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), obligatoire et financée par l’employeur :
Cette formation se déroule sur le temps de travail, sans déduction des heures de délégation. Les frais pédagogiques, de transport (tarif SNCF 2ᵉ classe) et de séjour (barème fonction publique) sont pris en charge par l’employeur. L’OPCO peut aussi intervenir pour rembourser une partie des coûts.
À retenir
Moins de 50 salariés = pas de budget CSE. Les élus disposent d’un local, de panneaux d’affichage et d’une formation SSCT obligatoire financée par l’employeur.
À partir de 50 salariés, le CSE devient une instance dotée de la personnalité juridique et de véritables moyens financiers. Il gère deux budgets distincts :
Bien que souvent confondus, le budget de fonctionnement et le budget ASC répondent à des logiques très différentes. Le premier finance l’activité et l’autonomie du CSE, tandis que le second est destiné aux avantages sociaux et culturels des salariés. Ce tableau récapitulatif permet de visualiser rapidement leurs règles de calcul, leurs modalités et leurs particularités.
| Budget | Règles de calcul | Modalités | Particularités |
|---|---|---|---|
| Budget de fonctionnement (AEP) | Fixé par la loi : - 0,20 % de la masse salariale DSN (50 à 1 999 salariés) - 0,22 % (≥ 2 000 salariés) |
Versé en une fois ou par tranches régulières, à condition que le CSE puisse fonctionner correctement. |
L’employeur peut déduire certains moyens déjà fournis (fournitures, appui administratif), mais pas les obligations légales (local, réunions obligatoires). |
| Budget ASC | Déterminé par accord d’entreprise ou convention collective. À défaut, il ne peut pas être inférieur à celui de l’année précédente. |
Pas de pourcentage légal uniforme. La contribution dépend de l’accord ou de l’historique. |
En pratique, représente en moyenne 0,8 % de la masse salariale (estimation Sénat). |
Le CSE bénéficie de plusieurs moyens matériels et de formations indispensables à l’exercice de ses missions. L’employeur doit mettre à disposition un local équipé et un panneau d’affichage réservé aux communications du comité. Les élus ont également accès à deux types de formations obligatoires :
5 jours minimum au premier mandat,
3 jours minimum en cas de renouvellement dans les entreprises de moins de 300 salariés,
5 jours minimum en cas de renouvellement dans les entreprises de 300 salariés et plus ou pour les membres de la commission SSCT.
À retenir
À partir de 50 salariés, le CSE change de dimension : il dispose de ressources financières propres et devient un acteur central de la vie sociale et économique de l’entreprise.
Le budget de fonctionnement du CSE (aussi appelé budget AEP pour attributions économiques et professionnelles) garantit l’indépendance de l’instance. Sans lui, impossible pour les élus d’analyser les comptes de l’entreprise, de financer leurs formations économiques ou de communiquer efficacement avec les salariés.
Le montant est fixé par le Code du travail (article L.2315-61) et dépend de l’effectif de l’entreprise :
Exemple : Une entreprise de 800 salariés déclare une masse salariale DSN de 30 M€. Son CSE reçoit 30 000 000 × 0,20 % = 60 000 € pour son fonctionnement.
La base de calcul : la DSN
Depuis 2018, le budget de fonctionnement du CSE est calculé sur la masse salariale issue de la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Ce document mensuel, transmis par l’employeur aux organismes sociaux, centralise l’ensemble des données liées aux salaires, cotisations et déclarations fiscales.
Contrairement à l’ancienne base du compte 641 du plan comptable général, la DSN exclut certaines indemnités de rupture (légales, conventionnelles ou transactionnelles). Cela peut réduire légèrement le montant des subventions CSE par rapport à l’ancien système.
Le budget de fonctionnement doit être versé chaque année par l’employeur. La loi ne fixe pas de calendrier précis, mais elle impose une règle fondamentale : le CSE doit disposer en permanence des moyens nécessaires pour remplir ses missions.
En pratique, deux modes de versement sont possibles :
Certaines entreprises prévoient même un versement mensuel aligné sur le calendrier de la paie, afin de garantir une continuité de trésorerie pour le comité.
Dans tous les cas, les modalités choisies doivent être claires, stables et transparentes. Elles peuvent être inscrites dans le règlement intérieur du CSE pour éviter tout litige.
Référence légale
Selon l’article L.2315-61 du Code du travail, l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement annuelle égale à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés et 0,22 % dans celles d’au moins 2 000 salariés.
La jurisprudence précise que cette dotation doit permettre au comité de fonctionner correctement, ce qui implique un versement régulier et suffisant.
La loi autorise l’employeur à déduire de sa contribution certaines dépenses déjà mises à disposition du CSE, à condition qu’elles soient directement liées au fonctionnement du comité. Ce mécanisme existe depuis les anciens comités d’entreprise et reste valable pour le CSE.
| Dépenses déductibles | Dépenses non déductibles |
|---|---|
| Fournitures et matériel de bureau mis à disposition spécifiquement pour le fonctionnement du comité. | Le local du CSE : sa mise à disposition est une obligation légale de l’employeur (article L.2315-25 du Code du travail). |
| Rémunération d’un salarié mis à disposition du CSE pour des missions administratives (ex. secrétariat, comptabilité), à condition que son activité ne concerne pas les ASC. | Les frais liés aux réunions obligatoires (convocations, organisation, temps de travail des élus). |
| Appui logistique spécifique (ex. logiciel de gestion comptable destiné uniquement aux attributions économiques du CSE). | Les dépenses liées aux activités sociales et culturelles : toute mise à disposition de moyens servant à financer ou gérer des ASC. |
Toute déduction doit être précisée dans un accord écrit entre le CSE et l’employeur. En cas de désaccord, la jurisprudence rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, qui doit démontrer que la dépense profite réellement au fonctionnement du CSE.
Point juridique
La Cour de cassation a confirmé que seules les dépenses ayant un lien direct avec les attributions économiques et professionnelles du CSE peuvent être déduites (Cass. soc., 27 mai 2020, n°18-23.764). Les dépenses relevant des ASC ou des obligations légales de l’employeur ne peuvent pas être imputées au budget de fonctionnement.
Le budget de fonctionnement du CSE, ou budget AEP, est strictement encadré par la loi. Pour éviter toute erreur d’imputation et un éventuel redressement URSSAF, voici un récapitulatif clair des dépenses autorisées et interdites.
| Dépenses autorisées avec le budget AEP | Dépenses interdites avec le budget AEP |
|---|---|
| Formations économiques des membres titulaires du CSE (5 jours au 1er mandat, renouvelables après 4 ans). | Voyages d’entreprise ou sorties collectives. |
| Recours à des experts (comptable, juriste, etc.) pour analyser les comptes ou accompagner les élus. | Billetterie (cinéma, parcs d’attractions, spectacles). |
| Communication du CSE (site internet, affiches, newsletters). | Bons d’achat ou chèques-cadeaux distribués aux salariés. |
| Frais de fonctionnement courant : fournitures, abonnements, logiciels de gestion. | Objets publicitaires destinés aux salariés (mugs, stylos, sacs...). |
| Déplacements des élus dans le cadre de leurs missions. | Toute prestation sociale ou culturelle relevant du budget ASC. |
| Embauche de personnel dédié exclusivement à l’activité économique du CSE. | |
| Depuis 2018 : possibilité de financer la formation des délégués syndicaux ou représentants de proximité, si le CSE en délibère. |
⚠️ À noter
Ce tableau présente les cas les plus fréquents mais n’est pas exhaustif. Certaines dépenses peuvent être « mixtes » (ex. embauche d’un salarié gérant à la fois l’administratif et les ASC) et nécessitent une répartition entre budgets. En cas de doute, il est recommandé de se référer au Code du travail, aux accords CSE/employeur ou à la jurisprudence, voire de solliciter un avis juridique.
À côté du budget de fonctionnement, le CSE dispose d’un budget distinct dédié aux activités sociales et culturelles (ASC). Son objectif est simple : améliorer la qualité de vie des salariés et de leur famille en leur proposant des prestations sociales, culturelles ou de loisirs.
Le budget ASC sert à financer toutes les activités ou prestations qui profitent directement aux salariés, à leurs familles ou aux anciens salariés de l’entreprise.
Par nature, ces dépenses doivent avoir un caractère social ou culturel, sans lien avec les attributions économiques du CSE.
Exemples classiques :
Définition juridique
La jurisprudence définit les ASC comme « toute activité non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer leurs conditions d’emploi, de travail et de vie » (Cass. soc. 13 novembre 1975, n°73-14848).
Contrairement au budget de fonctionnement, le budget ASC n’est pas fixé par un pourcentage légal unique.
En pratique, selon le Sénat, le budget ASC représente en moyenne 0,8 % de la masse salariale en France.
En cas de doute sur la répartition entre budget de fonctionnement et budget ASC, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le budget ASC du CSE.
Le CSE dispose d’une grande liberté pour choisir les activités à financer, à condition de respecter deux principes :
Le CSE peut moduler certains avantages en fonction de critères objectifs, par exemple en adaptant le montant des aides selon le revenu fiscal de référence ou la situation familiale.
Les avantages financés par le budget ASC ne sont pas réservés uniquement aux salariés en poste : la loi et la jurisprudence encadrent précisément leur champ d’application.
Les avantages financés par le budget ASC sont en principe soumis aux cotisations sociales.
Cependant, certaines exonérations existent :
Exemple Un CSE distribue des chèques-cadeaux de 150 € à Noël. Ce montant est inférieur au plafond annuel de 5 % du PMSS (193 € en 2025), l’avantage est donc exonéré de cotisations sociales.
Règles de bonne gestion
Une gestion rigoureuse du budget ASC suppose :
Depuis la création du CSE en 2020, les élus disposent d’une nouveauté importante : la possibilité de transférer une partie de l’excédent d’un budget vers l’autre. Mais attention, cette souplesse est strictement encadrée par le Code du travail et ses décrets d’application.
En pratique, deux options s’offrent au comité en cas de reliquat en fin d’exercice :
Le mécanisme le plus simple reste le report : le CSE conserve son excédent d’un exercice à l’autre, sans limite de temps.
C’est la grande nouveauté introduite par l’ordonnance Macron et précisée par le décret du 29 décembre 2017 (modifiant l’art. R.2315-31-1 du Code du travail).
Ces transferts ne modifient pas la nature des budgets : les sommes transférées doivent toujours être utilisées conformément à la destination du budget receveur (ex. un transfert ASC → AEP ne permet pas de financer directement une sortie ou un voyage salarié).
Avant de décider un transfert
Réduire le budget AEP fragilise l’indépendance du CSE en limitant ses moyens pour financer expertises et formations. Un transfert AEP → ASC empêche aussi de demander à l’employeur la prise en charge d’une expertise pendant 3 ans avant et après. À l’inverse, un transfert ASC → AEP réduit les prestations sociales et culturelles, ce qui peut nuire à la crédibilité du comité.
Pour sécuriser la gestion et éviter tout risque de contestation, chaque transfert ou report doit suivre des règles précises :
Pour garantir la régularité des opérations et sécuriser la gestion, chaque transfert ou report doit obéir aux principes suivants :
En complément des subventions légales, le CSE peut générer ses propres ressources. Ces financements additionnels ne remplacent pas les budgets obligatoires versés par l’employeur, mais permettent d’accroître la capacité d’action du comité, à condition de respecter les règles comptables et juridiques.
Le comité peut organiser des manifestations ou événements qui génèrent des recettes :
Ces recettes sont assimilées à des activités sociales et culturelles et doivent donc être affectées au budget ASC. Elles permettent d’augmenter le volume d’avantages proposés aux salariés sans dépendre uniquement de la contribution patronale.
Le CSE a la possibilité de placer sa trésorerie, mais uniquement dans des produits financiers sécurisés.
Exemples courants : comptes à terme, obligations sécurisées ou livrets adaptés aux personnes morales.
Depuis le 1er janvier 2009, les CSE ne peuvent plus ouvrir de livret A. Les anciens CE qui en détenaient un avant cette date peuvent toutefois continuer à en bénéficier.
En tant que personne morale (article L.2315-23 du Code du travail), le CSE peut acquérir des biens immobiliers. Ces investissements sont strictement encadrés :
La jurisprudence confirme que le financement et la gestion de ces biens ne peuvent en aucun cas être imputés au budget de fonctionnement.
Points de vigilance
Quand il s’agit de finances, les élus du CSE marchent souvent sur une ligne fine : distinguer le budget de fonctionnement (AEP) du budget des activités sociales et culturelles (ASC). Une mauvaise imputation peut coûter cher, mais aussi entacher la crédibilité de l’instance.
Comme nous l’avons vu, le budget AEP donne au CSE les moyens de fonctionner : financer les formations économiques des élus, rémunérer un expert-comptable, couvrir les frais de déplacement liés au mandat ou encore maintenir un site internet institutionnel.
À l’inverse, le budget ASC est tourné vers les salariés et leurs familles : chèques-vacances, places de cinéma à tarif réduit, arbre de Noël, organisation de voyages ou mise à disposition d’un logement de vacances.
La règle paraît claire, AEP = fonctionnement du CSE, ASC = avantages salariés. Mais dans la pratique, la frontière est souvent beaucoup plus floue.
La jurisprudence rappelle régulièrement que l’important n’est pas ce qui est écrit sur la facture ou la manière dont un prestataire présente son service. Ce qui compte, c’est l’usage réel de la dépense.
Référence jurisprudentielle
Dans un arrêt du 20 mai 1997 (Cass. soc., n°95-17296), la Cour de cassation a jugé qu’une secrétaire employée par un comité d’entreprise et affectée principalement à la gestion des activités sociales et culturelles ne pouvait pas être rémunérée uniquement par le budget de fonctionnement. La haute juridiction a imposé une ventilation de sa rémunération entre les deux budgets, proportionnellement au temps consacré à l’AEP et aux ASC.
Bien gérer les moyens du CSE, c’est d’abord savoir distinguer le budget de fonctionnement (AEP) du budget ASC et documenter chaque choix : finalité de la dépense, base DSN pour les calculs, vote en réunion, traçabilité comptable. Cette rigueur protège le comité (et ses élus) en cas de contrôle, tout en garantissant que l’argent public ou parapublic sert exactement son objet : faire fonctionner l’instance d’un côté, améliorer la vie des salariés de l’autre.
Retenez trois réflexes :
En appliquant ces principes, le CSE gagne en crédibilité, en impact social et en sécurité juridique. Les salariés y voient plus clair, l’employeur aussi, et l’instance peut se concentrer sur l’essentiel : représenter, informer, protéger et accompagner.
La gestion du budget de fonctionnement du CSE suscite de nombreuses interrogations chez les élus : dépenses autorisées, calcul, report des excédents, interdictions… Pour vous aider à y voir clair, nous avons rassemblé ici les réponses aux questions les plus fréquentes.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences