Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
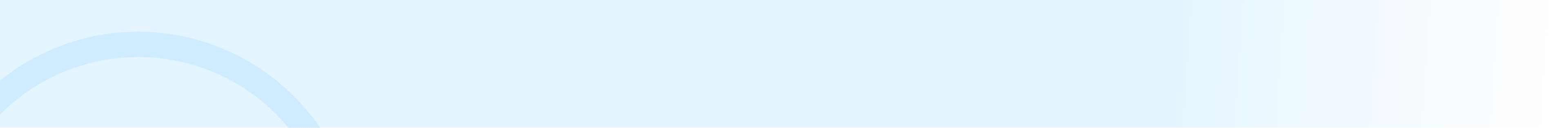
Un câble endommagé, une armoire sous tension, une simple prise mal fixée… Il suffit d’un instant pour qu’un accident électrique survienne. Invisibles, souvent sous-estimés, les risques électriques touchent tous les secteurs, pas seulement les électriciens. Cet article vous guide, point par point, pour comprendre les obligations, adopter les bons réflexes et sécuriser durablement vos installations et vos équipes.
Sources officielles utilisées :
- INRS : brochures ED 807, ED 974, ED 6127, documentation sur le risque électrique
- Legifrance : articles L. 4121-1 à L. 4121-5, R. 4215-1 à R. 4215-17, R. 4226-1 à R. 4226-21, R. 4544-1 à R. 4544-11 du Code du travail
- Norme NF C 18-510 : opérations sur ou à proximité des installations électriques
- Norme NF EN 50110-1 : exploitation et maintenance des installations électriques
- Norme NF EN 61140 : protection contre les chocs électriques
- Norme NF EN 60529 : degrés de protection IP
- Norme NF EN 62262 : degrés de protection IK
- Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux vérifications périodiques
- Arrêté du 26 décembre 2011 fixant les modalités des contrôles réglementaires
- OPPBTP : guides prévention et sécurité sur les chantiers
Temps de lecture : 20 minutes
Le risque électrique désigne un ensemble de dangers invisibles, parfois mortels, qui surviennent dès qu’une installation est sous tension. Qu’on intervienne directement sur une armoire électrique ou simplement à proximité, l’exposition existe, et chaque opération doit être rigoureusement anticipée.
Le contact direct se produit lorsqu’une personne entre en contact physique avec une partie active d’un circuit : câble dénudé, borne sous tension, pièce métallique alimentée… Il peut provoquer une électrisation ou une électrocution immédiate.
Le contact indirect, lui, survient lorsqu’un élément métallique censé être inactif (carcasse d’un appareil, enveloppe métallique) se retrouve accidentellement mis sous tension à cause d’un défaut d’isolement. Une simple main posée au mauvais endroit peut suffire.
Ces deux types de contact sont les causes les plus fréquentes d’accidents graves en milieu professionnel.
Même sans contact physique, d'autres types de risques existent :
Beaucoup d’accidents surviennent lors de travaux qui n’ont rien d’électrique en apparence : peinture, nettoyage, forage…
Mais si ces interventions se déroulent à proximité d’une zone sous tension ou de câbles enterrés, les conséquences peuvent être dramatiques.
C’est pourquoi le risque électrique concerne tout le monde, pas uniquement les électriciens. Il est du devoir de l’employeur de former, informer et protéger l’ensemble des salariés concernés.
Bon à savoir :
Selon l’INRS, une majorité des accidents électriques graves ou mortels surviennent lors d’opérations réalisées sans habilitation ou par des personnes non formées au risque électrique.
Avant toute opération, électrique ou non, une analyse préalable du risque électrique est obligatoire. C’est une exigence réglementaire, mais surtout une condition indispensable pour garantir la sécurité des intervenants.
Chaque intervention (maintenance, nettoyage, pose de matériel, déplacement d’une gaine) peut exposer à un danger invisible.
L’analyse du risque permet d’identifier les points de vigilance, de prévoir les protections nécessaires et d’éviter les erreurs d’interprétation.
L’analyse ne peut pas se limiter à une simple appréciation visuelle. Elle repose sur plusieurs paramètres à examiner en détail :
Chaque critère a un impact direct sur le niveau de risque et sur les mesures de prévention à mettre en place.
C’est l’employeur qui détient la responsabilité globale de l’analyse du risque, comme le stipule le Code du travail. Cependant, cette mission implique plusieurs niveaux d’acteurs :
Cette répartition claire des rôles permet d’éviter les angles morts dans la prévention et de responsabiliser chaque intervenant à son niveau.
Références réglementaires :
- Article L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail : obligations générales de prévention pour l’employeur
- Article R. 4544-1 à R. 4544-11 : prescriptions spécifiques pour les opérations sur les installations ou dans leur voisinage
- Norme NF C 18-510 : exigences relatives à l’analyse du risque électrique et à la consignation
- Norme NF EN 50110-1 : exploitation et maintenance des installations électriques – principes de sécurité
Toute opération doit faire l’objet d’une analyse actualisée en fonction de l’environnement, des équipements et des conditions d’intervention.
La prévention des risques électriques commence bien avant l’intervention : elle s’inscrit dès la conception des installations. Toute installation électrique mal pensée devient, à terme, une source de danger pour les travailleurs. Les exigences réglementaires imposent donc des règles strictes de conception, d’isolation et de protection.
Les articles R. 4215-1 à R. 4215-17 du Code du travail imposent aux maîtres d’ouvrage de construire ou aménager tout bâtiment accueillant des travailleurs avec des installations électriques conformes aux règles de sécurité.
Objectif : prévenir les risques de :
Cela concerne notamment les choix de matériel, les schémas de liaison à la terre, les dispositifs de coupure, les protections différentielles et les distances d’isolement.
Le contact direct survient lorsqu’un opérateur touche une pièce normalement sous tension. Pour éviter cela, plusieurs solutions techniques existent :
Le contact indirect se produit lorsqu’un corps conducteur devient accidentellement sous tension (carcasse métallique, outil…).
Les protections possibles sont :
Les surintensités sont des augmentations anormales du courant électrique dans un circuit. Elles peuvent provoquer des échauffements, des détériorations d’équipements ou même des incendies si elles ne sont pas correctement maîtrisées. Il en existe deux types :
Pour limiter ces risques, les installations doivent intégrer des dispositifs de protection comme des disjoncteurs, des fusibles ou des relais thermiques. Ces équipements coupent automatiquement l’alimentation dès que le courant dépasse une valeur définie pendant un temps donné.
Tous les équipements électriques ne se valent pas en matière de sécurité. La norme NF EN 61140 définit quatre classes de matériel, en fonction de leur niveau d’isolation et de leur capacité à éviter les contacts électriques dangereux.
| Classe | Description | Autorisation en entreprise |
|---|---|---|
| Classe 0 | Aucune liaison à la terre, protection uniquement par isolation de base | Interdite sur les lieux de travail |
| Classe I | Isolation standard + connexion obligatoire des parties métalliques à la terre | Autorisée pour les équipements fixes |
| Classe II | Double isolation (ou isolation renforcée), sans mise à la terre | Recommandée pour les appareils portatifs |
| Classe III | Alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS ou TBTP) | Obligatoire dans les milieux humides ou confinés |
Chaque classe est adaptée à un contexte précis. Utiliser un matériel mal classé dans un environnement à risque augmente considérablement les probabilités d’accident.
Lorsqu’on installe un équipement électrique, il faut s’assurer qu’il est capable de résister à son environnement : poussière, humidité, chocs… C’est exactement ce que mesurent les degrés de protection.
Le degré de protection IP, défini par la norme NF EN 60529, évalue la capacité d’un appareil à résister à l’intrusion de corps étrangers solides (comme la poussière ou un objet) et à la pénétration de l’eau.
En complément, le code IK, défini par la norme NF EN 62262, indique la résistance de l’équipement aux chocs mécaniques.
C’est ce qui permet d’évaluer sa robustesse face à une chute d’objet ou à un coup accidentel. Le niveau va de IK00 (aucune protection) à IK10 (résistance aux impacts les plus forts, jusqu’à 20 joules).
En résumé : sécuriser une installation dès sa conception, c’est…
Même bien conçue, une installation électrique peut devenir dangereuse si elle n’est pas entretenue, vérifiée et maintenue en conformité. C’est pourquoi la réglementation impose à l’employeur de procéder à des vérifications initiales et périodiques, afin de prévenir tout défaut pouvant exposer les salariés à un risque électrique.
Les articles R. 4226-1 à R. 4226-21 précisent que l’employeur doit veiller au bon état des installations électriques présentes dans l’établissement. Il est tenu de :
Quand vérifier une installation électrique ?
Les contrôles doivent avoir lieu avant la mise en service d’une installation neuve ou modifiée, afin d’en valider la conformité. Ils doivent ensuite être réalisés périodiquement, selon la nature des locaux et les exigences réglementaires, en général tous les un à trois ans. Enfin, une vérification peut être exigée à la suite d’une mise en demeure de l’inspection du travail, notamment après un signalement ou un accident.
Les vérifications doivent être confiées :
Dans tous les cas, les résultats doivent être formalisés. L’employeur doit tenir à jour un registre des vérifications, auquel sont annexés les rapports complets, les dates de contrôle et les mesures correctives mises en œuvre si nécessaire.
Références réglementaires :
- Code du travail – articles R. 4226-1 à R. 4226-21 : obligations de vérification et d’entretien des installations électriques
- Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 : vérifications périodiques des équipements et installations techniques
- Arrêté du 26 décembre 2011 : modalités pratiques des contrôles (périodicité, critères, organismes agréés)
Une installation conforme ne suffit pas. Dès qu’une opération est programmée, qu’il s’agisse de maintenance, de contrôle, ou même d’un simple remplacement de pièce, l’intervention doit être préparée, encadrée et sécurisée. Le Code du travail impose une règle de base : tout doit être fait pour supprimer le risque électrique, ou à défaut, le réduire autant que possible.
L’article R. 4544-4 du Code du travail est sans équivoque : les opérations sur ou à proximité des installations doivent être effectuées hors tension, chaque fois que cela est techniquement réalisable. Travailler hors tension permet d'éliminer totalement le risque d’électrisation. C’est la seule configuration réellement sûre.
Pour garantir l’absence de tension, il est obligatoire de suivre une procédure rigoureuse, appelée consignation, détaillée dans la norme NF C 18-510. Cette procédure comprend plusieurs étapes incontournables :
Aucune de ces étapes ne peut être ignorée ou réalisée partiellement.
Certaines situations empêchent de couper totalement l’alimentation : par exemple, lors d’opérations sur des installations critiques qui ne peuvent être arrêtées (alarmes, équipements médicaux, systèmes de sécurité…). Dans ces cas exceptionnels, on parle de travail sous tension ou au voisinage de pièces nues sous tension.
Dans ce contexte, des mesures de protection complémentaires doivent impérativement être mises en place : éloignement physique, barrières ou protecteurs isolants, écrans souples, surveillance par une personne habilitée, équipement de protection renforcé… L’objectif est de limiter au maximum l’exposition au risque, même lorsque celui-ci ne peut pas être éliminé.
Références :
- Code du travail – Article R. 4544-4 : priorité au travail hors tension
- Norme NF C 18-510 : procédure de consignation
- Norme NF C 18-550 : interventions sur véhicules et engins électriques
Aucune intervention présentant un risque électrique ne peut être réalisée sans que la personne concernée ne soit habilitée. L’habilitation électrique atteste que le salarié a reçu une formation adaptée, qu’il a été évalué, et qu’il a été autorisé par son employeur à effectuer certaines tâches en toute sécurité.
Le Code du travail, via les articles R. 4544-9 à R. 4544-11, impose à l’employeur de délivrer une habilitation à tout salarié réalisant ou encadrant des opérations électriques. Cette habilitation repose sur trois piliers :
La norme NF C 18-510 définit les symboles d’habilitation (B0, H1V, BR, etc.) en fonction du type d’intervention, du domaine de tension et du niveau de responsabilité.
L’habilitation n’est ni un diplôme, ni une certification à vie. Elle doit être réévaluée régulièrement (en général tous les trois ans) ou dès qu’un changement d’activité, de poste ou de procédure le justifie. L’employeur doit s’assurer que les connaissances et les comportements sont toujours à jour.
Il peut retirer l’habilitation à tout moment, notamment en cas de manquement aux règles de sécurité ou si le salarié ne remplit plus les conditions initiales.
Délivrer une habilitation engage la responsabilité de l’employeur. Il doit :
Cela implique aussi de ne jamais confier une opération électrique à un salarié non habilité, même ponctuellement.
À retenir sur la formation au risque électrique :
Toute personne exposée à un risque électrique doit être formée avant d’être habilitée. Cette formation, obligatoire selon les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, combine théorie et pratique pour développer une véritable culture de sécurité. Elle permet d’apprendre à repérer les dangers, adopter les bons gestes, et réagir en cas d’incident.
Un recyclage est recommandé tous les trois ans, ou dès qu’un changement de poste ou de matériel l’impose. L’employeur est responsable du suivi et de la traçabilité de ces formations.

Le risque électrique est souvent invisible. C’est précisément ce qui le rend si dangereux. Une pièce peut être sous tension sans aucun signe extérieur. Pour éviter toute exposition accidentelle, la réglementation impose de matérialiser les zones à risque, de façon claire, visible et impossible à ignorer.
Tout local ou emplacement présentant un risque électrique doit être délimité physiquement (par une barrière, un ruban, un écran) et signalé par un panneau d’avertissement réglementaire. Cette signalisation doit respecter les normes en vigueur, notamment celles relatives aux signaux de sécurité visuelle.
Lorsqu’une intervention nécessite l’ouverture d’un coffret ou d’une armoire, un balisage temporaire doit être mis en place. Il doit empêcher tout accès involontaire, même bref, à la zone de danger.
Au-delà de la signalisation réglementaire, des consignes simples doivent être diffusées et rappelées :
Ces règles peuvent sembler évidentes, mais de nombreux accidents surviennent justement parce qu’elles ne sont pas systématiquement respectées — ou parce qu’elles n’ont jamais été expliquées.
Chiffre :
Environ 2 300 accidents d’origine électrique sont recensés chaque année en milieu professionnel en France. Parmi eux, 51 % concernent des salariés non électriciens, souvent exposés lors d’opérations simples ou banales. Ce chiffre rappelle l’importance de diffuser des consignes claires à l’ensemble des équipes, quel que soit leur métier.
Un chantier, un atelier, une cuisine professionnelle ou une salle informatique n’impliquent pas les mêmes niveaux de risque, ni les mêmes contraintes. La signalisation doit être proportionnée au danger réel, et visible en toutes circonstances : éclairage, hauteur de vue, obstacles… Rien ne doit empêcher un salarié d’être alerté.
Dans la prévention du risque électrique, les équipements de protection individuelle (EPI) ne sont jamais le premier réflexe. Ils n’interviennent qu’en complément, lorsque les autres mesures de prévention, élimination du risque, consignation, balisage, isolement, ne suffisent pas.
Pour aller plus loin : quels EPI utiliser, comment les choisir, les entretenir ?
Dans le domaine du risque électrique, les responsabilités sont clairement définies. C’est l’employeur qui porte la responsabilité légale de la sécurité de ses salariés, y compris lorsqu’il délègue certaines tâches à des encadrants ou à des prestataires. Il lui revient de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque électrique, informer, former et protéger.
Les textes sont clairs : l’employeur doit procéder à une évaluation des risques professionnels, incluant les risques électriques, et mettre en œuvre les moyens de prévention adaptés. Cela implique :
L’absence de l’un de ces éléments engage sa responsabilité, notamment en cas d’accident.
La prévention ne s’arrête pas à l’employeur. Chaque intervenant a un rôle à jouer, selon sa fonction :
Mais dans tous les cas, c’est l’employeur qui est juridiquement responsable.
À retenir :
L’évaluation des risques, la formation, l’habilitation et la traçabilité sont des obligations légales. Leur absence peut engager la responsabilité de l’employeur, même si l’accident semble résulter d’une erreur individuelle.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences