Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
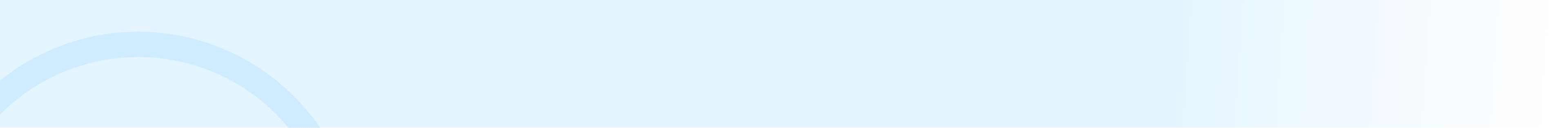
Près d’un salarié sur deux affirme avoir déjà été confronté à des propos ou comportements sexistes au travail (Observatoire Sexisme au travail – Fondation Jean-Jaurès / Ifop, 2023). Derrière ce constat, une réalité préoccupante : le harcèlement sexuel et les agissements sexistes continuent de miner la santé des salariés et l’ambiance professionnelle.
Face à cette urgence, le législateur a réagi. Depuis 2019, chaque comité social et économique (CSE) doit désigner un référent harcèlement chargé de devenir un interlocuteur identifié sur ces questions. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, un second référent doit être nommé par l’employeur.
Mais qui peut être désigné ? Comment se déroule le vote ? Et surtout, que recouvre réellement ce rôle dans la pratique ?
Depuis le 1er janvier 2019, chaque comité social et économique (CSE) doit désigner un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L.2314-1 du Code du travail).
Cette obligation concerne toutes les entreprises disposant d’un CSE, quel que soit l’effectif : de 11 salariés aux grands groupes.
L’absence de désignation constitue un délit d’entrave au fonctionnement du CSE, sanctionné par une amende pouvant atteindre 7 500 €.
Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes doit obligatoirement être choisi parmi les membres du CSE. La loi ne fixe pas de profil unique : il peut s’agir d’un élu titulaire, d’un suppléant ou, selon certaines interprétations, d’un représentant syndical au CSE.
Cette dernière possibilité reste toutefois discutée sur le plan juridique, car elle n’est pas expressément prévue par le Code du travail. En l’absence de décision claire des juges, certains comités choisissent malgré tout d’élargir le champ de la désignation afin d’intégrer davantage de compétences à la prévention.
Contrairement à d’autres fonctions spécifiques, le référent harcèlement ne bénéficie pas d’un statut protecteur supplémentaire. Sa protection reste celle attachée à tout membre élu du CSE.
Enfin, il n’est pas nécessaire que ce référent siège également à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Si sa présence peut faciliter les échanges et renforcer la prévention, ce n’est pas une condition légale.
Les élus du CSE bénéficient d’un statut de salarié protégé : l’employeur ne peut pas les licencier sans l’autorisation de l’inspection du travail. Cette protection s’applique pendant toute la durée du mandat et jusqu’à 6 mois après son terme, ainsi qu’aux candidats non élus. Le référent harcèlement, en tant que membre du CSE, profite de cette protection mais ne dispose pas de droits supplémentaires spécifiques.
La désignation du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes se fait dès la première réunion du CSE qui suit les élections professionnelles. Ce point doit figurer à l’ordre du jour et être inscrit au procès-verbal.
La désignation passe par un vote officiel, que l’on appelle une résolution.
Concrètement, cela signifie que :
Le président du CSE (généralement l’employeur ou son représentant) peut participer au vote. Toutefois, sa voix ne compte pas double : elle est intégrée dans le décompte global, sans caractère prépondérant.
Le mandat du référent est directement lié à celui du CSE.
Refuser de désigner un référent, ou ne pas organiser le vote, constitue un délit d’entrave au bon fonctionnement du CSE. Les élus s’exposent alors à une amende pouvant atteindre 7 500 € et à une contestation de la régularité du comité.
La loi oblige le CSE à désigner un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes (article L.2314-1 du Code du travail). En revanche, elle ne définit pas précisément ses missions. Contrairement au secrétaire ou au trésorier du comité, le rôle du référent n’est pas cadré par un article de loi.
Ce sont donc les élus du CSE qui doivent donner du contenu à cette mission, en cohérence avec les actions de prévention du comité et, le cas échéant, avec la CSSCT (Commission santé, sécurité et conditions de travail).
Il est essentiel de rappeler que le référent n’endosse aucune responsabilité juridique en cas de harcèlement dans l’entreprise.
Cette distinction est importante : le référent n’est pas là pour se substituer à l’employeur, mais pour renforcer l’efficacité de la prévention et améliorer l’accompagnement des salariés.
En pratique, les missions confiées au référent peuvent être adaptées selon la taille de l’entreprise et la maturité du CSE. Parmi les plus fréquentes :
| Mission | Objectif |
|---|---|
| Écouter et recueillir la parole | Être un point de contact identifié pour les salariés victimes ou témoins de comportements sexistes ou de harcèlement sexuel. |
| Orienter et accompagner | Diriger les personnes concernées vers les bons interlocuteurs : service de santé au travail, inspection du travail, associations spécialisées, etc. |
| Informer et sensibiliser | Relayer les droits des salariés, rappeler les procédures internes et promouvoir les actions de prévention (affichages, campagnes, sessions de sensibilisation). |
| Suivre et relayer les situations | Transmettre au CSE les cas signalés et assurer un suivi régulier des mesures prises par l’employeur. |
| Participer aux enquêtes internes | Représenter la voix des salariés lors d’une enquête déclenchée à la suite d’un signalement ou d’un droit d’alerte. |
le référent est avant tout un acteur de proximité :
À retenir sur le rôle du référent harcèlement CSE
La désignation est obligatoire (art. L.2314-1 du Code du travail), mais la loi ne définit pas ses missions en détail. Sa responsabilité juridique n’est pas engagée : la prévention du harcèlement reste du ressort de l’employeur (art. L.4121-1). Ses missions pratiques relèvent du CSE : écouter, orienter, informer, relayer et participer aux enquêtes. Il agit comme un relais de proximité : soutien pour les salariés, partenaire du CSE dans la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
La création du référent employeur en 2018, avec la loi Avenir professionnel, n’a rien d’un hasard. Contexte explosif : #MeToo, scandales à répétition, chiffres inquiétants. En 2015, le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle alertait déjà : une femme sur cinq déclarait avoir subi une forme de harcèlement sexuel au travail. Mais silence radio dans les entreprises. Pas de repères. Pas d’interlocuteur identifié.
Le législateur a tranché : l’obligation générale de sécurité (art. L.4121-1) ne suffisait plus. Il fallait un visage, une responsabilité claire. Ainsi naît le référent employeur : une personne désignée pour écouter, orienter, accompagner.
Le référent employeur représente la direction et son devoir de prévention ; le référent CSE incarne la vigilance des élus et la parole des salariés.
Le statut du référent employeur en bref
Base légale : article L.1153-5-1 du Code du travail.
Entreprises concernées : obligation à partir de 250 salariés.
Désignation : faite directement par l’employeur (souvent RH, prévention ou QHSE).
Statut : salarié de l’entreprise, sans mandat représentatif ni statut protecteur spécifique.
Missions : orienter, informer, accompagner les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
Être nommé référent harcèlement au CSE, c’est endosser une mission sensible. Mais comment se préparer à écouter, orienter et accompagner sans se retrouver démuni ? La loi a prévu une réponse : un droit à formation, taillé pour renforcer son rôle et sa légitimité.
Comme tout élu du comité social et économique, le référent harcèlement bénéficie d’un droit à formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Ce droit est inscrit à l’article L.2315-18 du Code du travail.
La formation est obligatoire, se déroule sur le temps de travail et est intégralement financée par l’employeur (frais pédagogiques, déplacement, restauration).
En complément, le référent peut également suivre une formation spécifique consacrée à la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Ces modules, proposés par des organismes agréés, ne remplacent pas la SSCT mais l’enrichissent.
Cette spécialisation est vivement conseillée : elle donne des outils pratiques pour écouter, orienter et accompagner efficacement les salariés, bien au-delà du cadre théorique.
Se former avec oùFormer
Sur oùFormer, vous pouvez comparer et réserver des formations adaptées aux référents harcèlement du CSE. Les organismes partenaires proposent des modules spécialisés en prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel, en complément de la formation SSCT obligatoire. Un moyen concret de renforcer vos compétences et de sécuriser vos pratiques au sein du comité.
Les obligations liées au référent harcèlement soulèvent souvent des questions précises : qui doit être désigné, comment, quelle formation suivre, et sur quel cadre légal s’appuyer ? Cette FAQ apporte des réponses claires et documentées pour guider élus du CSE et employeurs.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences