Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
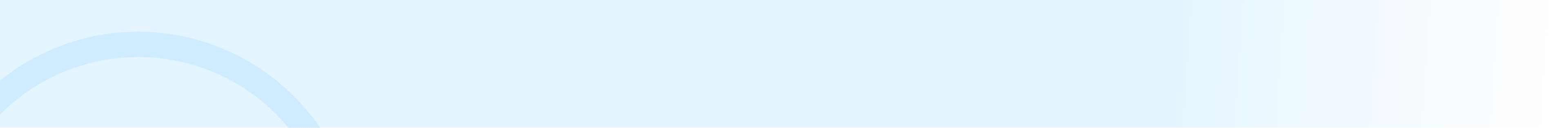
Près d’un salarié sur deux déclare avoir été confronté à un comportement sexiste ou sexuel au travail. Derrière ce constat, il y a des blagues déplacées, des gestes inappropriés, parfois des situations de chantage. Pour briser le silence et protéger les salariés, la loi impose depuis 2019 la désignation d’un référent harcèlement au sein du CSE. Qui est-il ? Quelles sont ses missions ? Et surtout, comment rendre son action réellement efficace ? Éclairage complet.
Depuis le 1er janvier 2019, chaque comité social et économique (CSE) doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Cette obligation découle de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a inséré cette exigence dans le Code du travail (art. L.2314-1).
Voici ce que cela implique :
Cette double obligation vise à renforcer la prévention et à offrir aux salariés deux relais identifiés pour signaler des situations à caractère sexiste ou sexuel.
À savoir : le défaut de désignation du référent peut être assimilé à un délit d’entrave au fonctionnement du CSE, passible d’une amende pouvant atteindre 7 500 € (Code du travail, art. L.2317-1).
Avant d’expliquer le rôle du référent, rappelons ce que recouvrent ces notions en droit du travail.
L’article L.1153-1 du Code du travail définit deux formes de harcèlement sexuel :
Selon une enquête Dares, 10 % des femmes et 2 % des hommes déclarent avoir subi une situation de harcèlement sexuel au travail dans les 12 derniers mois.
Introduits par la loi Rebsamen de 2015, ils sont définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Ils recouvrent par exemple :
D’après une étude OpinionWay/Ekilibre (2024), près d’un salarié sur deux (49 %) affirme avoir déjà été confronté à un comportement sexiste ou sexuel au travail.
Le référent harcèlement désigné par le CSE incarne un point de repère identifiable pour les salariés, un interlocuteur de confiance vers qui se tourner en cas de propos ou comportements inappropriés.
Son rôle repose sur trois grands axes :
En tant qu’élu du CSE, le référent dispose aussi d’un levier supplémentaire : le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (art. L.2312-5 du Code du travail). Ce pouvoir lui permet de déclencher une enquête conjointe avec l’employeur dès qu’un signalement sérieux lui est rapporté.
Dans les entreprises de plus de 250 salariés, son action s’articule avec celle du référent désigné par l’employeur, pour couvrir à la fois la proximité avec les salariés et la mise en œuvre des procédures internes.
Le rôle du référent harcèlement CSE varie en fonction de la taille de la structure et de l’existence ou non d’un référent côté employeur.
Le référent désigné par le CSE est souvent le seul interlocuteur officiel sur ces questions.
Il concentre donc l’ensemble des missions : informer, orienter, accompagner et, le cas échéant, alerter l’employeur lorsqu’une situation préoccupante lui est signalée.
Sa proximité avec les équipes facilite la remontée d’informations et la mise en confiance des salariés.
La loi impose un double dispositif : un référent CSE et un référent nommé par l’employeur.
Cette configuration permet de partager les responsabilités :
Une coopération entre les deux est fortement encouragée, notamment lors d’une enquête interne, afin d’assurer une approche équilibrée et crédible.
Le ministère du Travail recommande que les missions des deux référents soient articulées et complémentaires, pour éviter les doublons et renforcer la confiance des salariés dans le dispositif.
La désignation du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes se fait au sein même du CSE. Elle obéit à une procédure encadrée par le Code du travail :
Dans les entreprises de 250 salariés et plus, l’employeur désigne librement un second référent parmi l’ensemble des salariés. Ce choix est généralement porté sur un membre des ressources humaines, mais rien n’empêche de nommer un autre profil si cela paraît plus pertinent.
Pour en savoir plus sur la procédure de nomination du référent harcèlement au CSE, découvrez notre article dédié.
La loi ne prévoit pas de moyens spécifiques dédiés au référent harcèlement. Pourtant, sa mission exige du temps, des outils et une légitimité clairement définie.
En tant qu’élu, le référent bénéficie déjà des prérogatives attachées à son mandat :
Ces leviers donnent une base d’action solide, mais ils ne suffisent pas toujours pour assurer une mission efficace.
Découvrez comment le CSE peut mener une enquête en cas de harcèlement moral, étape clé pour protéger les salariés et garantir un traitement rigoureux des situations signalées.
À l’inverse, le référent nommé côté employeur (dans les entreprises de 250 salariés et plus) ne dispose d’aucune protection particulière ni de moyens légaux garantis.
Sa marge de manœuvre dépend donc largement :
L’absence de moyens clairement inscrits dans la loi peut freiner l’efficacité du référent, voire décourager les salariés d’endosser ce rôle sensible. C’est pourquoi de nombreuses entreprises choisissent de renforcer leur dispositif par des outils internes (procédure de signalement, boîte mail dédiée, partenariats avec des associations spécialisées).
Le rôle du référent harcèlement reste fragile en l’absence de moyens spécifiques clairement inscrits dans la loi. Pourtant, un levier majeur vient renforcer sa légitimité : la formation.
D’un côté, la formation obligatoire en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) fournit un socle commun. De l’autre, les formations spécialisées sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes apportent des outils pratiques indispensables pour assumer pleinement cette mission sensible.
L’article L.2315-18 du Code du travail impose à tous les membres du CSE, y compris au référent harcèlement, de suivre une formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) :
Cette formation financée par l’employeur aborde notamment la prévention des risques psychosociaux, dont le harcèlement sexuel et moral.
Si la formation SSCT constitue une première base, elle reste souvent trop généraliste. Le référent peut manquer de méthodes concrètes pour :
Pour renforcer leur rôle, de nombreux référents suivent des formations spécifiques sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ces modules courts (souvent d’une journée) permettent de :
Ces formations complémentaires ne sont pas obligatoires mais constituent un véritable levier pour donner au référent une légitimité renforcée auprès des salariés comme de la direction.
La mission du référent harcèlement ne s’arrête pas à l’écoute et à l’orientation. Pour être efficace, il doit aussi contribuer activement à une culture de prévention au sein de l’entreprise. Voici quelques initiatives concrètes, souvent mises en place avec succès.
| Axe d’action | Exemples concrets |
|---|---|
| Informer et sensibiliser régulièrement | - Organisation de campagnes internes (affiches, newsletters, modules e-learning). - Interventions lors des réunions d’équipe pour rappeler les règles et procédures de signalement. - Distribution de guides pratiques expliquant ce qu’est le harcèlement sexuel et les recours possibles. |
| Créer des espaces de dialogue sécurisés | - Mise en place de permanences confidentielles avec le référent. - Intégration de questions sur le climat de travail dans les enquêtes internes de satisfaction. - Ateliers d’échanges pour libérer la parole sur les comportements sexistes. |
| Renforcer les procédures internes | - Déploiement d’une boîte mail ou d’un numéro dédié aux signalements. - Participation à l’élaboration et à la mise à jour du règlement intérieur. - Coopération avec les RH, la médecine du travail et l’inspection du travail. |
| Promouvoir un climat de respect et d’égalité | - Actions contre les stéréotypes (répartition équitable des tâches, mixité dans les postes à responsabilités). - Campagnes internes contre les blagues sexistes ou comportements de domination. - Valorisation des bonnes pratiques managériales dans l’évaluation des responsables. |
Rien qu’en 2023, 247 enquêtes de harcèlement ont été menées à la demande de CSE ou de directions.
Le référent harcèlement CSE ne doit donc pas être perçu comme une contrainte légale. C’est un acteur de prévention et de confiance, à condition qu’il dispose d’une formation adaptée et de moyens concrets pour agir efficacement.
Sur oùFormer, vous pouvez comparer et réserver des formations référent harcèlement pour donner à vos élus les outils nécessaires et transformer cette obligation en véritable levier de protection et de confiance collective.
La désignation d’un référent harcèlement au sein du CSE soulève souvent des questions pratiques : cadre légal, missions, formation, moyens ou encore obligations d’affichage.
Voici les réponses aux interrogations les plus fréquentes, appuyées sur le Code du travail et les recommandations des autorités compétentes.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences