Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
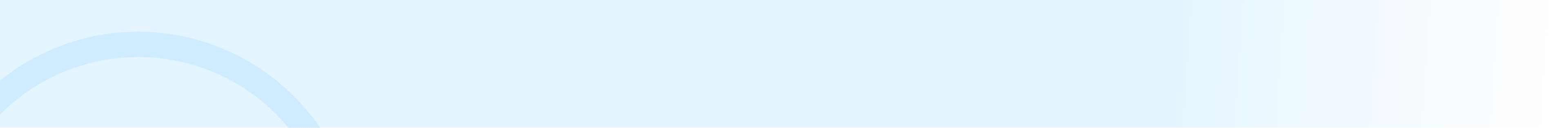
En France, le harcèlement moral représente la majorité des signalements reçus par le Défenseur des droits : 61 % des dossiers concernent ce sujet, loin devant les discriminations (23 %) et les violences sexistes ou sexuelles (16 %). Ces chiffres illustrent un phénomène massif, qui fragilise les salariés et engage directement la responsabilité des employeurs.
Dans ce contexte, le Comité social et économique (CSE) occupe une place stratégique. Ses élus doivent savoir déclencher une enquête, accompagner les victimes et travailler avec l’employeur pour que les faits cessent et que des mesures durables soient mises en place. Cet article propose un décryptage complet : définitions, cadre juridique, rôle du CSE, déroulement d’une enquête et bonnes pratiques pour sécuriser les procédures.
En France, plus d’un salarié sur trois déclare avoir déjà été victime de harcèlement au travail (baromètre Qualisocial × Ipsos, 2022). Derrière ces chiffres, des réalités parfois invisibles : mises à l’écart, humiliations répétées, conditions de travail volontairement dégradées. Le droit distingue clairement le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Comprendre ces notions est la première étape pour savoir comment agir et protéger efficacement les salariés.
Le Code du travail (art. L.1152-1) définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail d’un salarié. Ces faits peuvent porter atteinte à ses droits, à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale, ou encore compromettre son avenir professionnel.
Le Code pénal (art. 222-33-2) en fait également une infraction, rappelant que ces comportements ne relèvent pas seulement d’un manquement disciplinaire, mais peuvent aussi engager la responsabilité pénale de leur auteur.
Selon le baromètre Qualisocial × Ipsos 2022, 44 % des salariés estiment ne pas être suffisamment informés sur la législation en matière de harcèlement, et seuls 4 % déclarent être capables d’identifier clairement une situation de harcèlement. Dans la fonction publique, d’autres enquêtes confirment l’ampleur du phénomène : entre 32 % et 40 % des agents disent avoir déjà été confrontés à de telles situations.
Derrière ces notions proches se cachent des réalités juridiques bien distinctes. Les différencier permet de mieux comprendre les obligations de l’employeur et les droits des salariés.
Le harcèlement au travail ne prend pas une seule forme : il peut s’exercer de manière verticale, horizontale ou même résulter d’une politique d’entreprise, récemment reconnue par la justice comme « harcèlement institutionnel ».
| Forme de harcèlement | Définition | Exemples concrets |
|---|---|---|
| Vertical descendant | Un supérieur hiérarchique harcèle un salarié. | Critiques injustifiées, isolement, sanctions répétées. |
| Vertical ascendant | Un subordonné harcèle son manager. | Remises en cause constantes de l’autorité, menaces, dénigrement. |
| Horizontal | Le harcèlement s’exerce entre collègues sans lien hiérarchique. | Moqueries, rumeurs, exclusion d’un groupe de travail. |
| Institutionnel | Depuis 2025, reconnu par la Cour de cassation : une politique d’entreprise, décidée en connaissance de cause, dégrade les conditions de travail. | Réorganisation brutale, objectifs irréalistes, méthodes managériales pathogènes. |
Pour comprendre le rôle du CSE et le déroulement d’une enquête, il faut d’abord revenir au cadre légal : les textes qui encadrent le harcèlement moral et les obligations strictes imposées à l’employeur.
Le Code du travail (art. L.1152-1) interdit strictement « tout agissement répété de harcèlement moral qui a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cette disposition s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, et concerne aussi bien les employeurs que les collègues ou toute personne présente dans l’environnement professionnel.
Autrement dit, l’employeur n’a pas seulement un rôle disciplinaire : il est tenu de prévenir, détecter et traiter toute situation de harcèlement moral signalée ou constatée dans l’entreprise.
Au-delà de l’interdiction, l’article L.4121-1 du Code du travail impose à l’employeur une obligation générale de sécurité : il doit protéger la santé physique et mentale des salariés.
Pendant longtemps, la jurisprudence parlait d’une obligation de sécurité de résultat : l’employeur était responsable dès lors qu’un salarié subissait un harcèlement, même s’il avait mis en place des mesures de prévention. Depuis 2015, la Cour de cassation a nuancé cette approche en parlant d’obligation de moyens renforcés. Concrètement :
En cas de manquement, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts devant le conseil de prud’hommes.
Le défaut de réaction de l’employeur face à une alerte constitue un manquement grave à son obligation de sécurité. Les conséquences peuvent être lourdes :
Jurisprudence marquante : la Cour de cassation considère qu’un employeur qui n’ordonne pas d’enquête interne immédiatement après la dénonciation de faits manque à son obligation de sécurité, même si les faits ne sont pas établis au final (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551).
L’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2025 constitue une évolution historique. La haute juridiction reconnaît désormais que le harcèlement moral peut aussi être institutionnel.
La Cour a précisé que :
Pour les élus du CSE, cette décision renforce considérablement les leviers d’action : ils peuvent dénoncer des méthodes managériales pathogènes non seulement comme des risques psychosociaux, mais aussi comme des faits relevant du harcèlement moral institutionnel.
Au-delà des obligations de l’employeur, le CSE et, le cas échéant, la CSSCT jouent un rôle déterminant. Ils peuvent déclencher une alerte, mener une enquête conjointe, recourir à une expertise et assurer la protection des victimes comme des témoins.
Dès qu’un élu du CSE constate, ou est informé, d’une atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé d’un salarié, il peut déclencher le droit d’alerte (art. L.2312-59 C. trav.). L’employeur a alors l’obligation de diligenter une enquête immédiate et conjointe avec le CSE, puis de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation.
L’enquête est menée par l’employeur avec un représentant du CSE. Elle doit respecter plusieurs principes :
Lorsque le CSE estime qu’il existe un risque grave, identifié et actuel, il peut voter le recours à un expert habilité (art. L.2315-94 C. trav.). L’expertise permet d’objectiver les faits, d’analyser les causes profondes et de proposer des pistes de prévention.
Dans ce cas, les frais sont en principe entièrement à la charge de l’employeur, sauf exception prévue par la loi (certains cas de cofinancement 80/20).
Le Code du travail prévoit une protection renforcée (art. L.1152-2 et L.1152-3) :
Le CSE et la CSSCT jouent un rôle clé dans :
Une fois le signalement effectué et l’enquête déclenchée, plusieurs étapes clés doivent être respectées pour garantir à la fois l’impartialité, la confidentialité et la protection des salariés.
La première démarche consiste à entendre la victime présumée. L’entretien doit se dérouler dans un climat de confiance, sans intimidation, et permettre au salarié d’exposer librement les faits.
Ensuite, le salarié mis en cause doit également être entendu. Même si les éléments recueillis à ce stade paraissent accablants, il doit bénéficier du droit de présenter sa version et d’apporter ses arguments.
L’audition des deux parties est indispensable pour garantir le respect du contradictoire et éviter toute accusation de partialité.
L’enquête ne peut se limiter aux propos de la victime et de l’auteur présumé. Elle doit intégrer :
Les témoignages anonymes peuvent orienter une enquête interne, mais ils ne suffisent pas devant un juge. La Cour de cassation a rappelé qu’aucune décision ne peut être fondée uniquement ou de manière déterminante sur des preuves anonymes (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-18.241).
Tant que l’enquête est en cours, l’employeur doit protéger la victime présumée et préserver l’équilibre du collectif de travail. Il peut décider de :
Ces mesures sont provisoires et n’anticipent pas la sanction : elles visent à éviter tout contact nocif en attendant la conclusion de l’enquête.
L’enquête doit aboutir à un rapport écrit retraçant de manière factuelle et chronologique :
Le rapport est ensuite présenté :
Quand un signalement de harcèlement survient, l’entreprise doit réagir sans attendre. Deux priorités s’imposent : protéger immédiatement les personnes concernées et mettre en place des actions de prévention pour éviter la répétition des situations.
| Objectif | Actions immédiates | Prévention à long terme |
|---|---|---|
| Protéger la victime | Éloigner du mis en cause, aménagement de poste, soutien psychologique, confidentialité. | Mise en place de procédures de signalement claires et accessibles. |
| Gérer le mis en cause | Mise à pied conservatoire, audition dans le cadre de l’enquête, éventuelle sanction disciplinaire. | Formation des managers et rappel des obligations via le règlement intérieur. |
| Informer et encadrer | Affichage obligatoire, communication aux équipes sur les démarches en cours. | Mises à jour régulières du DUERP et du règlement intérieur, désignation des référents harcèlement. |
| Prévenir la récidive | Prendre rapidement des mesures pour faire cesser la situation en cours. | Campagnes de sensibilisation, ateliers sur les risques psychosociaux, suivi via le plan annuel de prévention. |
À retenir
Face à un signalement, l’entreprise doit protéger immédiatement la victime, sécuriser l’environnement de travail, sanctionner proportionnellement l’auteur, et surtout mettre en place des actions de prévention durable via l’information, la formation et l’évaluation des risques psychosociaux.
Selon l’Anact (2025), 49 % des salariés déclarent avoir été exposés à au moins un agissement à connotation sexiste ou sexuelle au travail sur les 12 derniers mois, tandis que seuls 19 % jugent les actions de leur entreprise suffisantes. Dans ce contexte, le référent harcèlement devient un appui concret pour orienter, informer et suivre les situations signalées.
Depuis la loi « Avenir professionnel » de 2018, toutes les entreprises de plus de 11 salariés doivent désigner, parmi les élus du CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (art. L.2314-1 et L.2315-18 C. trav.).
Dans les structures de plus de 250 salariés, un référent côté employeur doit également être nommé. Cette double présence permet de renforcer les relais d’information et d’action pour les salariés.
Le législateur n’a pas défini précisément les attributions du référent. C’est donc au CSE de leur donner corps et de les adapter à la réalité de l’entreprise. Parmi les missions généralement assumées :
Bien que son rôle soit central, le référent n’a aucune responsabilité juridique directe quant à l’existence ou non de faits de harcèlement. Cette responsabilité demeure exclusivement celle de l’employeur.
Pour être pleinement efficace, le référent doit bénéficier d’une formation adaptée. Celle-ci lui permet de :
Sur oùFormer, vous pouvez comparer et réserver facilement ces formations auprès d’organismes certifiés, pour donner aux référents les outils pratiques et juridiques dont ils ont besoin pour agir efficacement.
Lorsqu’un signalement de harcèlement moral est fait, l’employeur doit déclencher sans délai une enquête et prendre des mesures de protection. Mais il arrive que certains manquent à cette obligation. Dans ce cas, la loi et la jurisprudence offrent plusieurs recours.
Si l’employeur ne mène pas d’enquête ou refuse d’agir, le salarié concerné peut saisir le conseil de prud’hommes.
Plusieurs acteurs externes peuvent être sollicités pour briser l’inaction de l’employeur :
Bon à savoir
Inspection du travail, médecin du travail (SPST), syndicats ou associations spécialisées ne doivent pas être sollicités uniquement en cas d’inaction de l’employeur. Ils peuvent intervenir dès le signalement pour conseiller, protéger la victime, proposer des aménagements ou accompagner les démarches, et bien sûr relayer si l’employeur reste passif.
La Cour de cassation a posé une règle claire :
En pratique, l’enquête reste la voie la plus sûre pour démontrer la bonne foi de l’employeur, mais à défaut, ce dernier doit pouvoir prouver qu’il a mis en place des mesures de protection concrètes et immédiates. L’inaction totale, en revanche, expose systématiquement l’entreprise à un risque de condamnation.
L’enquête pour harcèlement moral n’est pas seulement une obligation juridique : c’est un exercice de responsabilité collective. Les élus du CSE participent activement à garantir la crédibilité de la démarche, à soutenir les salariés et à protéger l’entreprise contre les risques judiciaires et humains.
Dès qu’un signalement survient, le CSE doit agir sans délai : déclencher le droit d’alerte, demander l’ouverture de l’enquête, et veiller à ce que les mesures conservatoires soient prises.
La transparence est tout aussi essentielle : informer régulièrement les salariés des démarches engagées (sans violer la confidentialité), partager les résultats des enquêtes en réunion CSE, et assurer un suivi des actions décidées.
La prévention et la gestion du harcèlement reposent avant tout sur la confiance des salariés. Pour l’instaurer :
Un climat de confiance favorise la libération de la parole et évite que les situations ne s’enveniment dans le silence.
Les élus du CSE et le référent harcèlement doivent disposer des compétences nécessaires pour mener des enquêtes efficaces et sécurisées. Les formations dédiées couvrent :
Sur oùFormer, vous pouvez comparer et réserver des formations spécialisées pour les élus CSE et les référents harcèlement, proposées par des organismes certifiés.
Face à un signalement de harcèlement moral, élus du CSE, employeurs et salariés se posent souvent les mêmes questions : comment mener l’enquête, quels outils utiliser, comment rédiger un compte rendu ou conclure la procédure ? Cette FAQ rassemble les réponses pratiques, appuyées sur le Code du travail, la jurisprudence et les recommandations d’organismes de référence.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences