Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
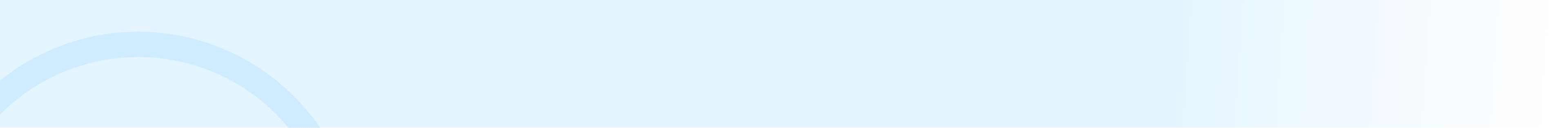
En 2024, plus de 67 000 entreprises françaises ont fait faillite, un record depuis dix ans selon l’IFRAP. Derrière ces chiffres, des milliers d’emplois menacés et des salariés qui découvrent souvent trop tard l’ampleur des difficultés. Le droit d’alerte économique du CSE a justement été pensé pour éviter ces situations : un outil préventif qui permet aux élus de détecter les signaux faibles, de questionner la direction et, si nécessaire, de saisir les organes de gouvernance. Comment fonctionne ce dispositif, et dans quels cas peut-il être déclenché ? Zoom sur un mécanisme juridique qui peut, à lui seul, changer le destin d’une entreprise.
Le droit d’alerte économique est défini par l’article L2312-63 du Code du travail. Il permet au CSE, lorsqu’il constate des faits de nature à compromettre la situation économique de l’entreprise (baisse des commandes, retards de paiement, difficultés de trésorerie…), de demander des explications à l’employeur.
Ce dispositif s’applique uniquement dans les entreprises de 50 salariés et plus, car il fait partie des attributions renforcées du CSE dans les structures de cette taille.
Si les réponses de l’employeur ne dissipent pas les inquiétudes, le CSE établit alors un rapport circonstancié. Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, ce travail peut être confié à la commission économique. Ce rapport est transmis à deux destinataires :
En pratique, ce mécanisme est conçu comme une alerte préventive pour éviter que les difficultés ne se transforment en crise ouverte ou en procédure collective.
Le droit d’alerte économique n’est pas le seul dont disposent les élus. Le Code du travail prévoit plusieurs dispositifs complémentaires, applicables selon la taille de l’entreprise :
| Type de droit d’alerte | Entreprises concernées | Base légale | Exemple concret |
|---|---|---|---|
| Atteinte aux droits des personnes | Dès 11 salariés | Art. L2312-59 | Harcèlement moral, discrimination |
| Danger grave et imminent | Dès 11 salariés | Art. L2312-60 + L4131-1 | Machine non sécurisée, exposition à un produit toxique |
| Risque pour la santé publique ou l’environnement | Dès 11 salariés | Art. L2312-62 | Procédé de fabrication polluant ou dangereux |
| Social | À partir de 50 salariés | Art. L2312-70 à L2312-71 | Recours massif aux CDD ou à l’intérim |
| Économique | À partir de 50 salariés | Art. L2312-63 à L2312-69 | Chute des commandes, difficultés financières |
Le droit d’alerte économique est défini par les articles L2312-63 à L2312-66 du Code du travail. Il encadre pas à pas la manière dont le CSE peut réagir lorsqu’il identifie des faits préoccupants pour la situation économique de l’entreprise. La procédure suit quatre étapes successives, de la demande d’explications à la transmission d’un rapport aux organes compétents.
Le déclenchement du droit d’alerte économique commence dès que le CSE repère des éléments laissant craindre une fragilisation de l’entreprise. Ces faits peuvent être visibles dans la gestion quotidienne (retards répétés de paiement aux fournisseurs, tensions de trésorerie) ou décelés dans les informations économiques remises au comité (chiffre d’affaires en baisse, endettement en hausse, pertes d’exploitation).
Dans ce cas, le CSE a la possibilité de demander formellement des explications à l’employeur.
La loi encadre strictement cette démarche : la demande est de plein droit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE (art. L2312-63 du Code du travail).
L’employeur ne peut donc pas repousser la discussion ou l’écarter, ce qui garantit que le sujet sera traité rapidement et officiellement.
Deux issues sont possibles :
Si les réponses fournies par l’employeur sont jugées insuffisantes ou si elles confirment la gravité de la situation, le CSE doit passer à la vitesse supérieure en rédigeant un rapport écrit.
Ce rapport a une valeur officielle : il consigne les constats du comité, détaille les faits préoccupants et formule un avis sur la situation économique.
Ce rapport constitue une preuve documentée que le CSE a rempli son rôle de vigilance. Il doit être précis, factuel, et étayé par des données (ex. évolution des commandes, dettes sociales, résultats financiers).
En pratique, trois objectifs :
À ce stade, le rapport devient un document pivot : il transforme une inquiétude exprimée en réunion en une démarche juridique formalisée, difficilement contestable par l’employeur.
Face à une situation économique complexe, le CSE n’a pas toujours les compétences techniques pour analyser en profondeur les comptes de l’entreprise. C’est pourquoi la loi prévoit la possibilité de se faire assister par un expert-comptable, une fois par exercice comptable (art. L2312-64 du Code du travail).
Cet expert va :
Le CSE peut aussi convoquer le commissaire aux comptes et associer deux salariés choisis pour leur compétence, qui disposent chacun de cinq heures rémunérées comme temps de travail pour contribuer au rapport.
Le choix de l’expert-comptable : ce que dit la loi
Lors d’un droit d’alerte économique, c’est le CSE qui choisit librement son expert-comptable, parmi les professionnels inscrits à l’Ordre. La décision doit être prise en réunion plénière par un vote à la majorité des élus présents. L’employeur ne peut pas s’opposer à ce choix et doit prendre en charge la totalité des honoraires (article L2315-92 du Code du travail).
Le rapport du CSE n’a pas vocation à rester interne : la loi prévoit qu’il soit porté à la connaissance des instances clés de l’entreprise (art. L2312-65 et L2312-66) pour garantir que les difficultés soient traitées.
Trois niveaux de transmission sont prévus :
En portant le sujet au niveau des instances stratégiques ou des associés, le CSE s’assure que la situation économique de l’entreprise devienne une priorité collective et non une simple discussion interne avec la direction.
À retenir - Le droit d’alerte économique en 4 étapes
1. Demande d’explications : le CSE interpelle l’employeur sur des faits préoccupants (art. L2312-63).
2. Rapport du CSE : si les réponses sont insuffisantes ou confirment les inquiétudes, le comité rédige un rapport transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes (art. L2312-63).
3. Recours à un expert-comptable : le CSE peut désigner un expert pour analyser la situation et l’assister dans la rédaction du rapport (art. L2315-92).
4. Transmission aux instances compétentes : le CSE peut décider de saisir le conseil d’administration ou de surveillance, ou d’informer directement les associés (art. L2312-65).
Le droit d’alerte économique est un outil puissant, mais il est encadré par plusieurs règles destinées à en garantir le sérieux et à prévenir les abus.
Les informations transmises au CSE dans le cadre de l’alerte ont un caractère confidentiel par nature.
Selon l’article L2312-67 du Code du travail, tout élu qui y a accès est tenu à une obligation de discrétion.
Cela signifie que les données financières, stratégiques ou sensibles ne peuvent pas être diffusées en dehors du comité. Cette garantie protège l’entreprise contre un risque de divulgation à des concurrents ou à des tiers.
Le législateur a prévu une sanction spécifique pour inciter les directions à respecter les procédures de consultation.
En cas de non-consultation du CSE sur certains sujets, notamment dans le cadre d’activités de recherche et développement, les aides publiques accordées à l’entreprise peuvent être suspendues (art. L2312-68 du Code du travail).
Pour utiliser efficacement le droit d’alerte économique, les élus doivent d’abord savoir si la situation de leur entreprise mérite réellement une alerte. La loi leur donne accès à des informations précises, qui varient selon l’effectif, et qu’il faut apprendre à décrypter.
Les obligations de transparence de l’employeur ne sont pas les mêmes dans une entreprise de 50, 300 ou 1 000 salariés : plus l’effectif est important, plus le CSE dispose d’informations pour exercer sa vigilance économique.
| Effectif | Informations mises à disposition | Base légale |
|---|---|---|
| 50 salariés et + | Consultation annuelle sur la situation économique et financière : bilans, comptes de résultat, rapports aux associés/actionnaires, perspectives d’activité… Toutes ces données sont centralisées dans la BDESE. | Art. L2312-25 C. trav. |
| 300 salariés et + | Transmission trimestrielle d’indicateurs précis : évolution des commandes, programmes de production, retards de paiement des cotisations sociales, évolution des effectifs par sexe et qualification. | Art. L2312-69 C. trav. |
L’article L2312-63 du Code du travail parle de “faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise”.
En pratique, il ne s’agit pas d’un événement isolé, mais d’un ensemble de signaux faibles ou forts.
Parmi les indicateurs que le CSE peut surveiller :
C’est la combinaison de plusieurs éléments préoccupants qui justifie une alerte.
La jurisprudence illustre concrètement les situations où le recours au droit d’alerte économique par le CSE a été jugé fondé.
Ces décisions montrent que le droit d’alerte économique est un outil préventif : il peut être déclenché bien avant une faillite, dès lors que l’avenir économique ou social de l’entreprise paraît menacé.
Dans les entreprises composées de plusieurs établissements, la règle est claire : seul le CSE central est compétent pour déclencher un droit d’alerte économique.
La Cour de cassation a jugé que cette prérogative appartient exclusivement au CSE central, car l’alerte économique vise la situation globale de l’entreprise, et non celle d’un seul établissement.
Ainsi, même si un établissement connaît des difficultés locales, son CSE ne peut pas déclencher la procédure d’alerte à lui seul.
Références jurisprudentielles
Cass. soc., 12 octobre 2005, n° 04-15794 : déjà à l’époque des comités d’entreprise (avant la création du CSE), la Cour avait affirmé la compétence exclusive du comité central.
Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 10-30126 : confirmation de cette position par la Cour de cassation.
Si le CSE central ne décide pas de mettre en œuvre la procédure, le CSE d’établissement ne peut pas “prendre le relais” ni déclencher une expertise dans ce cadre.
Toute délibération prise en ce sens par un CSE d’établissement est donc susceptible d’être annulée.
Il existe toutefois une nuance : un accord collectif ou un usage plus favorable peut élargir les prérogatives des CSE d’établissement et leur permettre de déclencher eux-mêmes le droit d’alerte économique (art. L2312-4 C. trav.).
En pratique, cela reste rare, mais certaines entreprises choisissent de renforcer la vigilance locale en partageant ce pouvoir avec les CSE d’établissement.
Tout au long de cet article, nous avons vu que le droit d’alerte économique du CSE repose sur une procédure rigoureuse : demande d’explications à l’employeur, rédaction d’un rapport si les inquiétudes persistent, possibilité de recourir à un expert-comptable, puis transmission aux organes de gouvernance. Nous avons aussi rappelé ses garanties et ses limites.
Bien utilisé, ce mécanisme permet d’anticiper les difficultés, de protéger l’emploi et de renforcer le dialogue social. Mais sa mise en œuvre exige des élus qu’ils sachent analyser les informations économiques, maîtriser le cadre juridique et travailler avec les experts.
Les formations CSE permettent aux élus de maîtriser concrètement le droit d’alerte économique : savoir analyser les données financières, utiliser la BDESE, rédiger un rapport solide, collaborer efficacement avec un expert-comptable et dialoguer avec la direction. Sur oùFormer, plusieurs organismes proposent des formations dédiées pour que les représentants du personnel transforment ce droit en véritable outil de prévention et de protection de l’emploi.
Complétez votre lecture
Quand déclencher une alerte ? Comment éviter les abus ? Quel rôle joue l’expert-comptable ? Autant de questions que se posent les élus confrontés à une situation économique préoccupante. Nous faisons le point avec des réponses précises, pour éclairer le fonctionnement concret du droit d’alerte économique du CSE.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences