Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
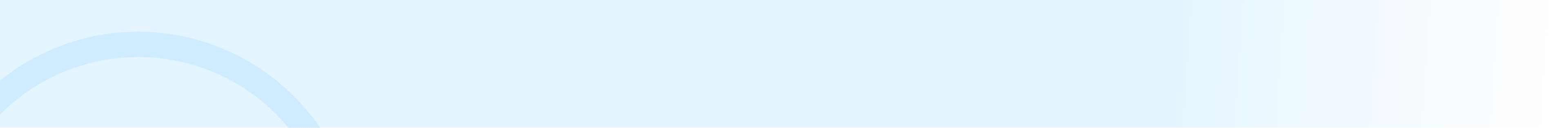
Chèques cadeaux, billetterie à tarif réduit, voyages subventionnés… Les activités sociales et culturelles (ASC) du Comité social et économique (CSE) occupent une place grandissante dans le dialogue social et le quotidien des salariés. En 2025, ces avantages CSE deviennent à la fois un levier de pouvoir d’achat et de cohésion, dans un cadre juridique rénové (fin des critères d’ancienneté) qui oblige les élus à repenser leur politique. Comment définir les ASC, financer un budget ASC optimal, respecter les règles de l’URSSAF et proposer des prestations attractives tout en renforçant la qualité de vie au travail ? Décryptage complet.
Avant d’aborder le budget ou les avantages concrets, il faut préciser ce que recouvrent les activités sociales et culturelles. Quelles actions entrent dans ce périmètre ? Qui peut en bénéficier ? Et quelles nouvelles règles s’appliquent depuis 2024-2025 ? Voici les repères indispensables pour comprendre les ASC aujourd’hui.
Le Code du travail ne donne pas une liste exhaustive des activités sociales et culturelles (ASC). Il en fixe seulement l’esprit : tout ce qui contribue au bien-être des salariés et de leur famille. Historiquement, cela inclut les cantines, coopératives, crèches d’entreprise, loisirs, culture et sport.
La jurisprudence a ensuite élargi la notion :
« Toutes les activités qui ne constituent pas une obligation pour l’employeur […] instituées principalement au profit des salariés […] pour améliorer leurs conditions d’emploi, de travail et de vie »
Autrement dit, dès lors qu’une dépense profite aux salariés et qu’aucun texte ne l’impose à l’employeur, elle peut relever des ASC.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024, confirmé en mars 2025, il est interdit de conditionner l’accès aux ASC à une ancienneté minimale.
Chaque salarié (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, apprenti, alternant ou même stagiaire) doit pouvoir en bénéficier dès son premier jour. Il est également interdit de moduler le montant d’un avantage selon l’ancienneté.
Exemple : offrir un chèque cadeau de 150 € aux salariés présents depuis plus de 2 ans et de 50 € seulement aux nouveaux arrivants est désormais considéré comme discriminatoire.
L’URSSAF a accordé une période de tolérance jusqu’au 31 décembre 2025 pour permettre aux CSE de mettre à jour leurs règlements internes. Passée cette date, tout manquement pourra entraîner un redressement.
Le principe est simple : toute personne figurant sur la liste du personnel de l’entreprise doit avoir accès aux ASC, sans délai, sans prorata ni condition d’ancienneté. Voici les principaux bénéficiaires.
| Profil | Droits aux ASC | Précisions |
|---|---|---|
| Salariés en CDI, CDD, temps partiel | Accès complet et immédiat aux avantages CSE | Pas de distinction selon le type de contrat ni le temps de travail |
| Apprentis, alternants, stagiaires | Bénéficient des ASC au même titre que les salariés | Interdiction légale de les exclure depuis 2011 |
| Salariés absents | Conservent leurs droits | Congé maternité, parental, arrêt maladie tant que le contrat n’est pas rompu |
| Ayants droit | Accès possible aux avantages CSE | Conjoints et enfants à charge (ex. Noël, rentrée scolaire) |
| Intérimaires | Accès aux installations collectives | Cantine, transports, bibliothèque ; autres avantages selon accords |
| Anciens salariés | Accès possible si le CSE le décide | Ex. retraités bénéficiant de paniers de Noël ou de billetterie ; à formaliser dans le règlement |
Combien l’employeur doit-il verser au titre des activités sociales et culturelles ? Sur quelle base se calcule ce budget et quelles sont ses limites ? Si le montant varie d’une entreprise à l’autre, le cadre juridique est précis et les usages bien établis. Voici ce qu’il faut savoir pour comprendre et sécuriser le financement des ASC.
À lire également
Pour sécuriser vos pratiques, consultez un rappel des obligations légales du CSE et le rôle joué par ses différentes commissions.
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) est une contribution de l’employeur, exprimée en pourcentage de la masse salariale brute. Contrairement au budget de fonctionnement (obligatoire : 0,20 % ou 0,22 % au-delà de 2 000 salariés), aucun taux légal minimal n’est fixé pour les ASC.
En pratique, le niveau de la subvention est déterminé par :
La contribution de l’employeur aux ASC se calcule à partir de la masse salariale brute soumise à cotisations sociales (article L.242-1 du Code de la sécurité sociale). La règle est de prendre la masse salariale brute de l’année précédente (N-1) comme base.
Masse salariale prise en compte pour le calcul ASC
✔ Inclus : salaires bruts, primes, gratifications et indemnités soumises à cotisations sociales.
✘ Exclus : indemnités liées à la rupture d’un CDI (licenciement, départ volontaire à la retraite, etc.).
Les deux enveloppes (ASC et fonctionnement) doivent être gérées séparément :
En cas de contrôle, l’URSSAF vérifie l’imputation correcte des dépenses et la cohérence avec les décisions du CSE.
Si la subvention employeur est la source principale, le CSE peut disposer de recettes complémentaires :
Transfert autorisé : jusqu’à 10 % de l’excédent du budget de fonctionnement non utilisé peut être versé vers le budget ASC en fin d’exercice. L’inverse est interdit.
En principe, les budgets du CSE sont étanches : impossible de financer une activité sociale avec le budget de fonctionnement, sauf à utiliser le transfert légal de 10 % de l’excédent annuel. Pourtant, certains comités mettent en place un prêt ponctuel du fonctionnement vers les ASC.
Pour rester légal, ce prêt doit être traité comme une véritable opération financière : contrat écrit, montant défini, taux d’intérêt et échéancier de remboursement respecté. Sans ce formalisme, l’opération serait requalifiée en transfert prohibé, avec un risque de redressement en cas de contrôle URSSAF.
En pratique, mieux vaut réserver cette solution à des situations exceptionnelles et privilégier le mécanisme sécurisé du transfert de 10 %.
Pour aller plus loin
Découvrez le rôle du CSE dans l’entreprise et explorez en détail les avantages CSE dont peuvent bénéficier les salariés.
Après avoir détaillé les règles de financement et de calcul, il est utile de résumer en un coup d’œil les rôles respectifs de l’employeur et du CSE, ainsi que les réflexes à adopter pour sécuriser la gestion. Le tableau ci-dessous vous offre une vision claire et rapide de ces responsabilités partagées.
| Acteur | Responsabilités | Bonnes pratiques |
|---|---|---|
| Employeur | - Verser la subvention ASC selon l’accord, la convention collective ou l’usage applicable - Respecter la base de calcul (masse salariale brute N-1) - Définir la périodicité de versement (annuel, semestriel, trimestriel) |
- Formaliser les modalités de versement dans un accord ou PV - Communiquer au CSE la masse salariale de référence |
| CSE | - Voter le budget ASC en début d’année et l’acter au PV - Programmer les actions et définir les critères d’éligibilité - Suivre mensuellement l’exécution budgétaire - Tenir une comptabilité et archiver tous les justificatifs ( au moins pendant 6 ans) - Publier un bilan annuel |
- Séparer strictement budget ASC et budget de fonctionnement - Utiliser des tableaux de bord de suivi - Archiver en numérique pour plus de sécurité et de traçabilité |
| En commun | - Garantir la transparence et la bonne utilisation des fonds - Assurer la conformité avec la réglementation |
- Vérifier régulièrement les textes applicables (accords, conventions, Code du travail) - Communiquer de façon claire auprès des salariés sur l’utilisation du budget |
Attribuer des avantages via le budget ASC ne dispense pas le CSE de respecter un cadre strict. L’URSSAF veille à ce qu’aucune prestation ne soit utilisée comme un complément de salaire déguisé. En cas de contrôle, la moindre irrégularité peut entraîner un redressement coûteux.
Par principe, toute somme ou prestation versée aux salariés est soumise à cotisations sociales, au même titre qu’un salaire.
Trois exceptions permettent l’exonération :
Pour aller plus loin
Service-public.fr – Bons d’achat et cadeaux aux salariés
URSSAF – Avantages en nature et frais professionnels
Références légales : article L.411-9 du Code du tourisme (chèques-vacances), article L.1271-12 du Code du travail (CESU), et lettre-circulaire ACOSS n° 2011-0000024.
Pour certaines prestations, l’URSSAF fixe des plafonds d’exonération. C’est notamment le cas des bons d’achat et chèques cadeaux.
En 2025, le plafond est fixé à 196 € par événement et par salarié (soit 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale). Au-delà, l’excédent est considéré comme un salaire et soumis aux cotisations sociales.
Exemple : un chèque cadeau de 150 € offert à Noël est totalement exonéré. En revanche, un chèque de 300 € entraîne la réintégration de 104 € dans l’assiette des cotisations sociales.
Pour bénéficier de l’exonération, les avantages doivent être liés à des événements précis : Noël, rentrée scolaire, mariage ou PACS, naissance, départ à la retraite, fête des mères/pères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas.
Attribuer un bon d’achat en dehors de ces occasions (par exemple « prime vacances ») expose le CSE à une requalification.
Rappel
Comme déjà évoqué, depuis 2024 (et confirmé en 2025), il est interdit de réserver un avantage ASC en fonction de l’ancienneté. Chaque salarié doit y avoir accès dès son premier jour, quel que soit son contrat ou son statut. Les seules modulations admises reposent sur des critères sociaux objectifs : quotient familial, revenu fiscal de référence ou nombre d’enfants à charge.
La pandémie de 2020 est loin derrière nous, mais c’est elle qui a fait naître des attentes fondamentales chez les salariés : besoin de lien, d’authenticité, mais aussi de soutien financier. En 2025, ces aspirations sont encore bien vivantes… et se heurtent à une inflation persistante, des salaires parfois à la peine, et des attentes sociales renouvelées. Comment les CSE peuvent-ils aujourd’hui proposer des ASC qui font sens et apportent une véritable plus-value ?
Privés de convivialité pendant les confinements, les salariés ont redécouvert la valeur symbolique des temps partagés. Aujourd’hui encore, les grandes initiatives fédératrices (Noëls collectifs, séminaires, sorties team-building, olympiades…) attirent et mobilisent massivement au-delà des discours. L’emblème ? La fête de Noël, autrefois digitalisée, revient en force dans sa formule la plus fédératrice, en présentiel et avec présence des familles.
Les actions mises en place pendant la crise pour soutenir le bien-être des salariés n’étaient pas un simple effet de mode : elles se sont installées durablement. Les ateliers de yoga, de sophrologie ou les séances de massage font désormais partie des prestations attendues. Une étude Gallup (2024, Gallup.com) souligne d’ailleurs que seuls 21 % des employés estiment que leur entreprise prend réellement soin de leur bien-être, un niveau historiquement bas qui confirme la pertinence de ces initiatives.
L’inflation ne cesse de peser sur les ménages : en 2022, les prix ont grimpé de 5,3 %, alors que les salaires progressaient seulement de 3,9 %, entraînant une baisse du pouvoir d’achat réel. Pour y répondre, les CSE misent sur des aides concrètes :
2025 : top 3 des ASC plébiscitées par les salariés
77 % des salariés considèrent le pouvoir d’achat et la qualité de vie au travail comme leur priorité n°1 (Europe 1, 2024). Dans ce contexte, les ASC ne sont plus accessoires : elles pèsent directement sur l’engagement et la fidélité.
Une aide à la garde d’enfants, des chèques-vacances ou un événement collectif réduisent le stress, favorisent la convivialité et créent un attachement à l’entreprise. Pour les employeurs, c’est aussi un atout de recrutement : un package CSE attractif peut faire la différence face à un concurrent.
L’enjeu pour les élus ? Penser les ASC comme un investissement stratégique, mesurable par la participation, les retours positifs et la baisse du turnover. Bien conçues, elles apportent ce « supplément d’âme » qui transforme la relation employeur-salarié.
Distribuer des chèques-cadeaux fait plaisir, mais ça ne suffit plus. En 2025, les élus doivent piloter leurs ASC comme une véritable stratégie sociale.
D’abord, connaître son public : un sondage interne évite de financer des activités boudées. Ensuite, diversifier : un mix d’avantages individuels et de moments collectifs crée plus de valeur qu’un “tout-chèque”. Vient la planification : sans feuille de route, le budget s’évapore avant l’hiver. Enfin, surveiller les comptes : ratio €/salarié, respect du plafond URSSAF, transparence totale.
La clé ? Anticiper et s’entourer. Formations, outils de suivi, experts comptables… Mieux vaut prévenir que réparer. Les ASC ne sont pas une charge, mais un levier : bien gérées, elles nourrissent le climat social et renforcent l’attractivité de l’entreprise.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences