Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
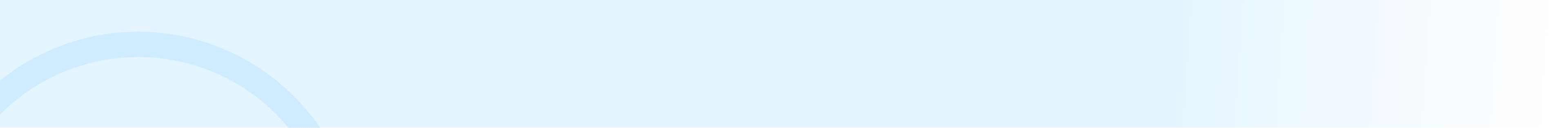
Dès 50 salariés, les entreprises doivent consacrer 0,20 % à 0,22 % de leur masse salariale brute au financement du comité social et économique. Derrière ces pourcentages se cachent des sommes parfois considérables : plusieurs centaines de milliers d’euros dans les structures de taille intermédiaire. Le budget CSE plus de 50 salariés devient alors un enjeu de gouvernance sociale, où se mêlent contraintes réglementaires, marges de manœuvre financières et attentes croissantes des collaborateurs.
Dans cet article, nous décryptons les règles, les usages et les risques liés à sa gestion.
À partir de 50 salariés, le CSE entre dans une nouvelle dimension : il n’a plus seulement un rôle de représentation, il dispose aussi de moyens financiers concrets pour agir. La loi prévoit en effet deux budgets distincts, chacun avec un objectif bien précis :
Chaque budget répond à une logique spécifique et doit être utilisé dans son cadre légal. C’est ce cloisonnement qui garantit la transparence et la légitimité des dépenses du comité.
Pour mieux comprendre comment s’organise cette instance, consultez notre guide sur la composition du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Commençons par détailler le budget de fonctionnement, celui qui donne aux élus les moyens de travailler au quotidien.
Le budget de fonctionnement du CSE est la première enveloppe mise à disposition par l’employeur. Son rôle est simple : donner aux élus les moyens de remplir efficacement leurs missions.
Le montant dépend directement de la masse salariale brute de l’entreprise :
Bon à savoir : la masse salariale brute
La masse salariale brute désigne l’ensemble des rémunérations versées aux salariés avant déduction des cotisations sociales. Elle inclut les salaires de base, les primes, les heures supplémentaires et les avantages en nature.
C’est cette base qui sert de référence pour calculer le budget de fonctionnement du CSE, conformément à l’article L2315-61 du Code du travail (Legifrance).
Ce budget couvre toutes les dépenses qui permettent aux élus d’être autonomes dans leur action :
Références légales : Le budget de fonctionnement du CSE est fixé par l’article L2315-61 du Code du travail. Il peut notamment financer la formation économique des élus (art. L2315-63) et certaines expertises prévues aux articles L2315-78 à L2315-81. L’article L2315-18 rappelle enfin que les élus doivent disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs missions.
Mais au-delà du fonctionnement du CSE, il existe un second budget qui parle davantage aux salariés : le budget des activités sociales et culturelles (ASC), véritable levier de bien-être et d’attractivité dans l’entreprise.
Si le budget de fonctionnement sert à faire vivre le comité, le budget ASC (Activités Sociales et Culturelles) est celui qui intéresse le plus directement les salariés. C’est grâce à lui que le CSE peut proposer des avantages concrets, renforcer la cohésion et soutenir le pouvoir d’achat.
La loi ne prévoit pas de pourcentage unique comme pour le fonctionnement. Le montant est défini par :
Le budget ASC a une finalité claire : améliorer la qualité de vie des salariés sans discrimination. Il peut financer par exemple :
Principe de non-discrimination et fin des conditions d’ancienneté : selon l’article L2312-78 du Code du travail, les avantages ASC doivent profiter à tous les salariés. En 2024, la Cour de cassation (arrêt n°22-16.812) a confirmé qu’une condition d’ancienneté ne peut plus être opposée, puisqu’elle constitue une discrimination indirecte. Une règle à surveiller de près pour les CSE.
Bon à savoir
L’URSSAF admet des exonérations de cotisations sociales pour certaines prestations financées par le budget ASC (bons d’achat, chèques culture, chèques vacances). Ces avantages restent exonérés uniquement si les règles d’attribution sont respectées, notamment le plafond 2025 fixé à 196 € par événement.
Le budget ASC ne sert pas seulement à améliorer le quotidien des salariés. C’est aussi un atout stratégique pour l’entreprise : proposer des avantages concrets, c’est renforcer la fidélité des équipes et séduire de futurs talents. Une étude de Glassdoor montre d’ailleurs que 57 % des candidats considèrent les avantages sociaux comme un critère décisif dans le choix d’un employeur. Autrement dit, bien utiliser ce budget, c’est aussi investir dans l’image et l’attractivité de l’entreprise.
Mais pour que tout fonctionne, il faut respecter une règle d’or : ne pas mélanger les deux budgets. Voyons pourquoi ce cloisonnement est si important.
Si le CSE dispose de deux budgets, ce n’est pas annodin : ils doivent rester séparés. Chacun doit être utilisé pour son objet précis.
Comme mentionné précédemment, Le budget de fonctionnement couvre les moyens du comité pour exercer ses missions, tandis que le budget ASC finance les avantages sociaux et culturels destinés aux salariés
Cette séparation est inscrite dans le Code du travail (art. L2315-61 et L2312-78) et confirmée par la jurisprudence. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé qu’une dépense mal imputée doit être réintégrée dans le bon budget, avec toutes les conséquences qui en découlent (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-31.171).
Certaines confusions reviennent régulièrement :
Dans tous ces cas, le risque est le même : un redressement URSSAF et l’obligation de corriger les comptes.
Il existe aussi des zones grises. Prenons les objets promotionnels par exemple :
Dans ce type de situation, il est indispensable de pouvoir justifier son choix en cas de contrôle.
La bonne pratique consiste à :
À retenir
Même si la loi n’impose pas l’ouverture de deux comptes séparés, il est fortement recommandé de gérer le budget de fonctionnement et le budget ASC sur des comptes bancaires distincts. Cela permet de garantir le respect du cloisonnement prévu par les articles L2315-61 et L2312-78 du Code du travail, et de sécuriser le CSE en cas de contrôle URSSAF.
Mais que se passe-t-il si le CSE dépense moins que prévu et se retrouve avec un excédent ? La loi prévoit des règles très précises sur le report et le transfert des reliquats, que nous allons voir dans la partie suivante.
Il arrive qu’en fin d’année, le CSE n’ait pas utilisé l’intégralité de ses budgets. On parle alors de reliquat ou d’excédent budgétaire. La loi encadre strictement leur gestion pour éviter toute confusion.
Lorsque le CSE n’utilise pas tout son budget, il peut choisir de reporter le reliquat sur l’exercice suivant, selon des règles différentes selon la nature du budget.
Le Code du travail et la jurisprudence encadrent strictement cette possibilité :
Ces transferts ne peuvent intervenir qu’à la clôture de l’exercice et doivent être décidés par une délibération en réunion CSE, inscrite au procès-verbal.
La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 20 octobre 2021 : le plafond de 10 % est impératif et toute décision contraire peut être annulée (Cass. soc., 20 oct. 2021, n° 20-18.514).
Conformément aux articles L2315-61 et L2312-84 du Code du travail, le CSE peut transférer une partie de l’excédent annuel d’un budget vers l’autre, dans la limite de 10 % et uniquement par délibération en fin d’exercice.
Le CSE peut également choisir de :
La gestion des budgets du CSE implique le respect de règles précises de comptabilité et de transparence. Chaque euro doit être imputé correctement, enregistré et justifié pour éviter tout risque de contestation ou de sanction.
Chaque budget doit apparaître séparément dans les comptes. Le suivi peut se faire par comptes bancaires distincts (fortement recommandé) ou par une comptabilité analytique rigoureuse. L’objectif : être capable de prouver, à tout moment, qu’une dépense correspond bien à l’objet du budget utilisé.
Le niveau d’exigence comptable varie selon la taille du CSE, avec des obligations qui s’alourdissent au-delà de certains seuils.
Dans tous les cas, les budgets doivent être présentés dans le rapport annuel d’activité et de gestion financière (art. L2315-69 du Code du travail).
Les salariés sont les premiers bénéficiaires des actions du CSE. Leur donner une vision claire de l’utilisation des budgets est une obligation légale, mais aussi un moyen d’entretenir la confiance.
Après la gestion transparente, il reste une question clé : que risque un CSE en cas de mauvaise utilisation de ses budgets ? C’est ce que nous allons voir dans la prochaine partie.
Un CSE qui n’impute pas correctement ses dépenses s’expose à des conséquences financières et juridiques sérieuses. Le cloisonnement des budgets n’est pas une recommandation, mais une obligation légale.
En cas de contrôle, l’URSSAF peut :
Si une dépense est mal affectée, le CSE peut être obligé de la réintégrer dans le bon budget. Cette correction peut fragiliser ses comptes et remettre en cause sa crédibilité auprès des salariés comme de l’employeur.
L’article 314-1 du Code pénal assimile l’utilisation abusive des budgets du CSE à un abus de confiance.
Contrairement aux structures de plus grande taille, le CSE des entreprises de moins de 50 salariés ne bénéficie d’aucun financement légal automatique.
La loi ne prévoit aucune subvention obligatoire pour couvrir les frais de fonctionnement du comité dans les entreprises de moins de 50 salariés. Les élus disposent seulement des heures de délégation pour exercer leurs missions.
L’employeur n’a pas non plus l’obligation de financer un budget dédié aux activités sociales et culturelles. Concrètement, cela signifie qu’il n’existe pas de billetterie, de chèques cadeaux ou d’aides sociales financées par le CSE, sauf accord spécifique.
Rien n’empêche cependant un employeur de mettre en place volontairement :
Ces pratiques ne sont pas encadrées par la loi mais peuvent résulter d’un accord d’entreprise ou d’un usage. Dans ce cas, l’employeur doit s’y tenir tant que l’accord ou l’usage n’est pas remis en cause.
Dès que l’entreprise franchit le seuil des 50 salariés, la gestion des budgets CSE devient un enjeu central. Entre le budget de fonctionnement, qui donne aux élus les moyens d’exercer leurs missions, et le budget ASC, qui améliore concrètement le quotidien des salariés, les règles sont précises et encadrées par le Code du travail.
Respecter le cloisonnement des budgets, anticiper les excédents, assurer une traçabilité comptable et communiquer en toute transparence : voilà les piliers d’une gestion sécurisée. Au-delà des contraintes légales, c’est aussi une formidable opportunité de renforcer la cohésion interne et l’attractivité de l’entreprise.
Bien gérés, les budgets CSE ne sont pas seulement une obligation : ils deviennent un levier stratégique au service des élus, des salariés et de la qualité de vie au travail.
Voici les réponses aux questions les plus courantes que se posent les élus et employeurs sur le budget CSE plus de 50 salariés.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences