Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
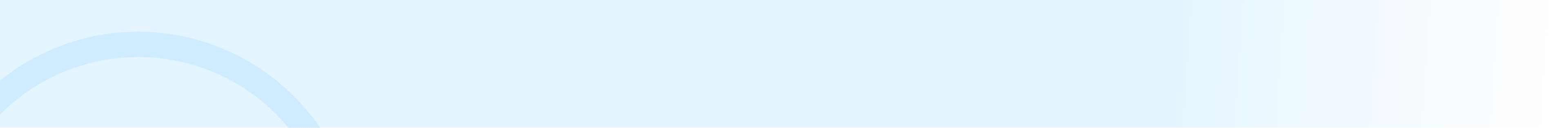
Chaque jour, plus de deux salariés perdent la vie dans le cadre de leur travail, tandis que plus de 1 500 accidents entraînent un arrêt. Ces chiffres rappellent une chose : sur de nombreux chantiers, entrepôts ou sites industriels, le risque fait partie du quotidien.
C’est dans ce contexte que le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a toute son importance. Présent dans les équipes, il est formé aux gestes qui sauvent et à l’observation des situations à risque. Il agit à la fois dans l’urgence et comme relais de prévention au quotidien.
Quel est son périmètre d’action ? Que peut-il faire concrètement en cas d’accident ? En quoi se distingue-t-il d’un secouriste grand public ? Et comment devenir SST au sein d’une entreprise ? Cet article revient en détail sur le rôle du SST.

Le risque fait partie du quotidien de nombreux professionnels. Un atelier en activité, un chantier en cours, une machine qui tourne... Lorsqu’un incident survient, il faut pouvoir agir. Le Sauveteur Secouriste du Travail est là pour ça : présent sur le terrain, il intervient dans les premières minutes, avant l’arrivée des secours.
Le SST est un salarié désigné pour assurer les premières actions en cas d’urgence. Il protège, alerte, applique ce qui a été appris, et s’en tient à ce cadre. Il n’est ni soignant ni expert, mais il sait comment réagir lorsque la situation l’exige.
Ce relais, pensé dans l’organisation de la sécurité, permet de ne pas laisser l’accident sans réponse. Il ne règle pas tout, mais il réduit souvent l’impact. Et parfois, cela suffit à faire la différence.
La présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail est exigée par l’article R.4224-15 du Code du travail dans les situations suivantes :
En dehors de ces cas précis, la formation de Sauveteurs Secouristes du Travail n’est pas imposée par un texte. Elle peut toutefois s’inscrire dans le cadre plus large de l’obligation de sécurité de l’employeur, définie à l’article L.4121-1 du Code du travail.
💡 À lire : employeurs : êtes-vous en règle avec l’obligation SST ?
Lorsqu’une personne se trouve en détresse, le SST commence par évaluer la situation et suit le plan d’intervention. Il sert de guide pour réagir efficacement en cas d’accident. Il se présente sous forme de logigramme illustré par des pictogrammes, facilitant la mémorisation. Ce plan suit à la fois l’ordre chronologique des gestes à accomplir et la gravité des situations. Il repose sur quatre étapes.
Avant même de porter secours, le SST doit analyser la situation. Un accident du travail peut survenir dans un environnement encore dangereux : une machine en mouvement, un câble électrique dénudé, une substance toxique dans l’air. Agir sans évaluer les risques pourrait aggraver la situation.
Premier réflexe : comprendre ce qu’il s’est passé.
Il interroge les témoins, observe les indices matériels et, si possible, échange avec la victime. Cette phase d’analyse permet d’identifier la nature de l’accident et les dangers potentiels.
Ensuite, il repère les risques persistants.
Le SST doit être capable de les reconnaître sans s’exposer lui-même. Il évalue s’il existe :
Puis il agit, selon la situation :
Une fois la zone sécurisée, le SST se concentre sur la victime. Cette étape repose sur une méthode précise, toujours dans le même ordre : vérifier s’il y a un saignement abondant, un étouffement, une perte de conscience ou un arrêt respiratoire. Chaque observation guide les gestes à venir.
Première étape : repérer un saignement. Une hémorragie externe peut entraîner la mort en quelques minutes. Le SST observe la victime et son environnement : taches au sol, vêtements imbibés, posture anormale… Même si le sang n’est pas visible, les circonstances (chute, choc, outil tranchant) peuvent laisser supposer un saignement interne. En cas de doute, il palpe prudemment les zones à risque.
Deuxième cas : l’étouffement. C’est plus rare sur un lieu de travail, mais cela peut arriver lors d’une pause repas ou sur une aire de repos. Si la victime ne peut plus parler, tousser ou émettre un son, le passage de l’air est probablement obstrué. Elle s’agite, porte les mains à la gorge : il s’agit d’un étouffement total, une urgence vitale immédiate.
Troisième étape : l’état de conscience. Le SST interpelle la victime : « Vous m’entendez ? » En l’absence de réponse, il tente de provoquer une réaction simple (prise de main, stimulation verbale ou tactile). Si rien ne se produit, il considère que la victime est inconsciente.
Enfin, la respiration. Il vérifie la présence de souffle pendant 10 secondes : oreille au-dessus de la bouche, joue pour sentir l’air, regard vers la poitrine. Aucun bruit, aucun mouvement ? C’est peut-être un arrêt cardiaque.
L’examen ne prend que quelques instants, mais chaque détail compte. Il ne s’agit pas de poser un diagnostic, mais d’agir dans le bon ordre, sans passer à côté d’un signe vital.
Dès qu’une urgence vitale est repérée, le SST doit déclencher l’alerte ou la faire déclencher. L’objectif est d’obtenir une prise en charge médicale dans les plus brefs délais, tout en continuant à s’occuper de la victime.
Qui prévenir ?
Dans l’entreprise, on suit l’organisation interne des secours (référent sécurité, personnel formé…).
En dehors, le choix du numéro dépend de la nature de l’urgence :
Comment déclencher l’alerte ?
Idéalement, le SST délègue cette tâche à un tiers, pour rester auprès de la victime. Il choisit une personne fiable, équipée d’un téléphone portable. Sinon, il alerte lui-même, sans quitter la scène plus que nécessaire.
Que dire ?
Le message transmis aux secours doit être clair, structuré et complet. Il suit toujours la même trame :
En cas d’alerte, chaque seconde compte. Le SST reste concentré, tout en veillant à ce que l’information circule efficacement.
Une fois l’alerte donnée, le SST intervient directement auprès de la victime, en attendant les secours. Son rôle ? Appliquer les gestes de secours adaptés, dans le respect de ses compétences. Ces gestes visent un seul objectif : préserver les fonctions vitales (conscience, respiration, circulation sanguine).
Tout dépend de la situation rencontrée. Le SST s’appuie alors sur ce qu’il a observé pendant la phase d’examen, et agit en conséquence :
Le SST reste toujours auprès de la victime, surveille son état, et adapte ses gestes si la situation évolue. Il prépare également l’arrivée des secours en leur transmettant toutes les informations utiles.
La mission du SST ne s’arrête pas à l’intervention. En dehors des situations d’urgence, il contribue activement à la prévention des risques dans son environnement de travail. Cette posture repose sur sa capacité à observer, à signaler et à participer à l’amélioration continue.
Il commence par repérer ce qui, dans le quotidien, peut se transformer en danger : un poste mal agencé, un matériel mal rangé, une consigne oubliée. Son rôle n’est pas de contrôler, mais de capter ces signaux faibles avant qu’un incident ne survienne.
Lorsqu’un risque est identifié, le SST peut le faire remonter, suggérer des ajustements ou simplement relayer une information utile. Il est aussi un interlocuteur de proximité, capable de rappeler une consigne, de répondre à une question sécurité ou de participer à l’accueil des nouveaux arrivants.
Dans certaines entreprises, son regard terrain alimente aussi le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). En partageant ses observations, il contribue à actualiser l’analyse des situations à risque, à mieux cibler les mesures de prévention et à inscrire sa vigilance dans une démarche collective.
La formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) est accessible à tous les salariés, sans prérequis ni connaissance préalable. C’est une formation courte, concrète, qui permet d’agir efficacement en cas d’accident sur le lieu de travail, tout en contribuant à la prévention des risques professionnels.
Devenir SST passe par une formation initiale de deux jours, dispensée par un formateur certifié selon le référentiel de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité). Elle alterne mises en situation pratiques, échanges de cas concrets, et apprentissage des gestes de secours. À l’issue de la session, une carte de SST est délivrée au salarié : elle est valable 24 mois et atteste de ses compétences à intervenir en cas d’urgence sur son lieu de travail.
Sur oùFormer, les entreprises peuvent rechercher en quelques clics une formation SST à jour, près de leurs locaux. Le moteur de recherche recense les sessions disponibles partout en France, en présentiel, pour tous les secteurs d’activité.
Un moyen simple d’assurer la sécurité sur le terrain… et de former des relais compétents au sein des équipes, en phase avec le rôle du SST : intervenir rapidement en cas d’urgence et contribuer activement à la prévention des risques professionnels.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences