Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
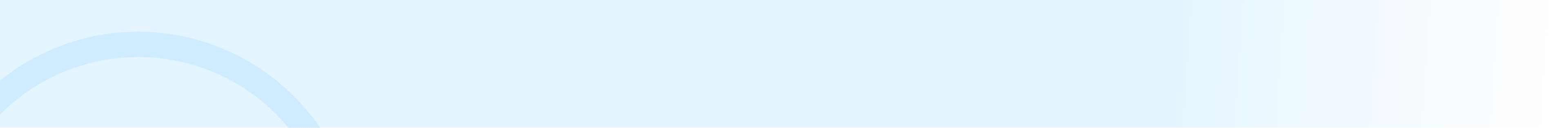
Un malaise, une chute, un accident sur machine… En entreprise, tout peut basculer en quelques secondes.
Le plan d’intervention SST permet de réagir immédiatement, selon un protocole structuré enseigné lors de la formation Sauveteur Secouriste du Travail. Il guide chaque action : protéger, examiner, alerter, secourir.
Ce déroulé repose sur les recommandations de l’INRS et du Code du travail. Il s’applique à toute situation d’urgence, avec des gestes simples, concrets et vitaux.
Dans ce guide, découvrez comment fonctionne ce plan, comment le mettre en œuvre et le transmettre efficacement à vos équipes.

Le plan d’intervention SST désigne la suite logique d’actions qu’un Sauveteur Secouriste du Travail doit suivre lorsqu’il est témoin d’un accident ou d’un malaise sur le lieu de travail. Il est enseigné pendant la formation SST, certifiée par l’INRS, et repose sur une approche systématique destinée à sauver des vies sans mettre en danger l’intervenant.
Ce plan a trois objectifs :
Le plan n’est pas un document administratif à afficher : c’est une procédure mentale et gestuelle que chaque SST doit connaître par cœur et être capable d’appliquer à tout moment. Il s’appuie sur 4 grandes actions : protéger, examiner, faire alerter, secourir.
Ce plan est applicable dans tous les secteurs d’activité, que ce soit en industrie, BTP, tertiaire, transport ou collectivités. Il s’adapte à la nature de l’accident, à l’environnement immédiat et à l’état de la victime.
Le plan d’intervention SST repose sur une méthode simple et universelle, articulée autour de quatre actions successives. Ce sont les piliers de toute intervention de secourisme en milieu professionnel, et chaque Sauveteur Secouriste du Travail est formé pour les exécuter dans cet ordre.
Avant toute chose, le SST doit évaluer la situation pour éviter un suraccident. Cela implique d’identifier les dangers persistants (risque électrique, feu, atmosphère toxique, chute d’objets, etc.) et de sécuriser la zone.
Si possible, il supprime le danger. Sinon, il l’isole ou en éloigne la victime uniquement en cas de danger vital.

Le SST sécurise la zone pour éviter tout suraccident avant d'intervenir sur la victime
Une fois la zone sécurisée, il faut évaluer l’état de la victime. Le SST vérifie si la personne :
Cette étape permet d’identifier une urgence vitale et de choisir les gestes adaptés (compression, position latérale de sécurité, massage cardiaque…).

Le SST évalue l’état de la victime pour détecter une urgence vitale et choisir les gestes adaptés
Le secouriste prévient les secours ou demande à un témoin de le faire. Le message d’alerte doit être clair, structuré et précis. Il mentionne le lieu exact de l’accident, la nature de l’incident, l’état apparent de la victime, les gestes déjà réalisés, ainsi que l’identité de la personne qui donne l’alerte.

Le SST fait alerter les secours avec un message clair, précis et complet sur la situation
Enfin, le SST réalise les gestes de secours adaptés, en attendant l’arrivée des professionnels. Il agit sans aggraver l’état de la victime et reste à ses côtés, tout en rassurant et surveillant les signes vitaux.

Tous les pictogrammes ne sont pas représentés ici. La version complète est disponible sur le site de l’INRS.
Le plan d’intervention SST n’est pas un simple rappel des bons gestes : c’est un enchaînement structuré, validé par l’INRS, qui permet d’agir vite et efficacement face à un accident. Le suivre à la lettre augmente les chances de survie et évite l’aggravation de la situation.
Chaque étape doit être appliquée dans l’ordre, sauf si la situation impose d’alerter immédiatement les secours (ex. : danger majeur non maîtrisable).
Avant toute action, le SST analyse l’environnement. Il repère les dangers persistants (électrocution, chute, émanation toxique, incendie, etc.) et s’assure que son intervention n’expose pas d’autres personnes.
Cette phase doit rester rapide (moins de 3 minutes), mais elle conditionne toute la suite de l’intervention.
Si le danger peut être supprimé sans risque supplémentaire, le SST agit : arrêt d’urgence d’une machine, fermeture d’une vanne, éloignement d’un produit toxique, etc.
Sinon, il isole la zone (avec des barrières, rubans, palettes…), sans déplacer la victime, sauf si celle-ci est en danger vital immédiat (incendie, effondrement, explosion en cours…).
Le SST doit ensuite évaluer l’état de la victime. Cette observation suit une logique précise.
Chaque geste est directement lié au constat réalisé à cette étape.
Si l’urgence vitale est confirmée, le SST alerte les secours spécialisés (ou délègue cette tâche à un témoin).
Le message doit être structuré et concis.
Selon l’INRS, un message mal formulé peut retarder leur intervention de 2 à 4 minutes. Or, en cas d’arrêt cardiaque, chaque minute sans action fait chuter les chances de survie de 10 %.
Enfin, le SST applique les gestes de secours conformes à sa formation, adaptés à la situation, et sans mettre la victime en danger supplémentaire.
Il reste présent jusqu’à l’arrivée des secours, surveille la victime, la rassure et peut adapter sa position ou son traitement si l’état évolue.
Tous ces gestes sont détaillés dans le référentiel national de compétences de l’INRS (v2023) et enseignés lors de la formation initiale ou du MAC SST.

Chaque entreprise est unique. Le plan d’intervention SST doit donc être adapté aux réalités du terrain, au-delà du socle commun enseigné en formation. Un bon plan ne se contente pas de suivre une procédure type : il anticipe les risques propres à votre activité, vos locaux et vos effectifs.
Un atelier de mécanique n’expose pas aux mêmes dangers qu’un bureau ou qu’un entrepôt logistique. Le plan d’intervention doit tenir compte :
Par exemple, dans une blanchisserie industrielle, on prévoit une procédure spécifique en cas de brûlure par vapeur. Dans un élevage, on inclut la gestion d’un écrasement par un animal.
Pensez à croiser les résultats du DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) avec les scénarios de premiers secours envisagés.
Le plan doit être ancré dans la réalité du lieu de travail. Il doit inclure :
Ce plan peut aussi intégrer un schéma d’évacuation et une fiche réflexe pour chaque type d’incident identifié comme probable ou critique.
Un plan d’intervention ne fonctionne que s’il est connu et maîtrisé. Il doit donc être présenté aux salariés, affiché de manière visible et testé en conditions réelles.
Les exercices peuvent être simples (simulation de malaise, appel fictif au 15, évacuation contrôlée), mais ils doivent être réguliers.
Un retour d’expérience (REX) après chaque simulation permet d’identifier les points d’amélioration et d’actualiser le plan.
Ce travail collectif renforce la culture sécurité et donne à chacun les bons réflexes en cas d’urgence.
Un plan d’intervention SST, même bien conçu, perd en efficacité s’il n’est pas testé, mis à jour et réévalué régulièrement. Les situations de travail évoluent, les équipes changent, les risques aussi. C’est pourquoi l’INRS recommande de considérer ce plan comme un outil vivant, à intégrer dans une logique d’amélioration continue.
Selon les recommandations INRS (ED 4085), le plan d’intervention doit être réexaminé chaque année, ou à chaque modification majeure :
Ce suivi garantit que les consignes restent adaptées au terrain, compréhensibles et immédiatement applicables.
Le meilleur moyen de vérifier qu’un plan d’intervention fonctionne, c’est de le tester. Organiser des exercices (prévus ou inopinés) permet de :
Selon l’INRS, une entreprise qui réalise des simulations de premiers secours au moins une fois par an divise par deux le temps de réaction moyen des équipes en cas d’accident réel. Et ce n’est pas tout, lors de simulations non préparées, les secouristes formés depuis plus de 18 mois ont oublié ou mal exécuté au moins une étape clé dans 34 % des cas (source : INRS, retour terrain – campagnes MAC SST).
Après chaque simulation ou situation réelle, il est essentiel de mener un REX (retour d’expérience). Ce débrief collectif permet d’identifier :
Les mises à jour du plan d’intervention doivent être cohérentes avec les autres outils de prévention de l’entreprise :
Mettre à jour ces documents en même temps que le plan d’intervention permet d’avoir une politique cohérente et à jour en matière de sécurité.
Être Sauveteur Secouriste du Travail (SST), ce n’est pas juste obtenir une attestation. C’est jouer un rôle actif et reconnu dans la sécurité de l’entreprise. Le plan d’intervention SST n’est efficace que s’il est porté par des personnes formées, identifiées et impliquées.
Le SST n’intervient pas uniquement en cas d’urgence. Il est aussi un relai de terrain, capable de :
Cette posture est encouragée par l’INRS : le SST est un acteur de prévention au quotidien, pas seulement un “secouriste d’urgence”.
La présence de SST formés est obligatoire dans certains contextes (article R4224-15 du Code du travail), mais elle est valorisée dans toutes les entreprises, notamment :
Quand une situation critique survient, le SST est souvent le premier visage rassurant que voit la victime. Il prend les choses en main, agit avec calme, communique clairement avec les secours et maintient la cohésion autour de lui.
C’est aussi cela, le rôle d’un SST : faire preuve de sang-froid, de bienveillance et d’efficacité dans les moments qui comptent.
Ces chiffres renforcent la nécessité d’un plan d’intervention SST bien conçu, testé et connu de tous.
À lire aussi : Réglementation et obligations SST
Le SST en entreprise : définition et missions
Une présentation claire du rôle du Sauveteur Secouriste du Travail et de ses deux volets : intervention et prévention.
Certification SST : contenu, durée, validité
Tout ce que couvre la formation SST, de ses objectifs à sa reconnaissance officielle.
Prévenir les risques : le rôle concret du SST au quotidien
Comment le SST contribue à améliorer la sécurité, au-delà des situations d’urgence.
Obligations légales : êtes-vous conforme au Code du travail ?
Ce que la loi impose aux employeurs et les points à vérifier pour être en règle.
Infos
Trouver le bon CACESComprendre l'habilitation éléctriqueMentions légalesConditions d'utilisationNous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences